 |
| |
Les réservoirs sont, avec
les captages, les ouvrages essentiels du réseau
d'alimentation en eau potable du S.I.E.A. de La Faye. Ils permettent
non seulement de stocker l'eau, mais également de
réduire la pression que l'eau acquiert à l'intérieur
des canalisations au gré des pentes et des dénivellations
des terrains qu'elles parcourent. Les réservoirs sont aussi
les régulateurs entre la production des captages et
la distribution vers les abonnés. Ainsi, ils vont anticiper
les variations de la consommation en se vidant dans la journée,
période des plus fortes consommations, et en se remplissant
durant la nuit.
Sur le S.I.E.A. de La Faye, les réservoirs
sont tous dits semi-enterrés par opposition aux châteaux
d'eau qui sont ni plus ni moins que des réservoirs placés
en hauteur sur des tours afin de mettre l'eau sous pression dans
les canalisations de distribution. Ici, il n'y a pas besoin de telles
constructions car le paysage valloné du Livradois-Forez avec
ses nombreuses pentes permet d'avoir des pressions d'eau suffisantes
dans les canalisations. Au contraire, dans certaines conduites,
la pression est telle qu'il faut installer des réducteurs
de pression ou des ouvrages spécifiques comme les brise-pressions
afin de réduire la force qu'exerce l'eau dans les tuyaux.
L'ensemble des réservoirs du S.I.E.A. de
La Faye permettent de stocker près de 3940 m3
d'eau potable et distribuent plus de 800 m3
d'eau par jour en moyenne.
Comme les captages,
les réservoirs semi-enterrés sont construits en béton.
Leur capacité de stockage dépend du nombre d'habitants,
d'industriels et d'agriculteurs qu'ils doivent alimenter. Le dimensionnement
d'un réservoir est un procédé complexe car
il doit prendre en compte l'évolution de la population et
ses habitudes de consommation, et prendre en compte le fait que
l'eau ne doit pas stagner dans le réservoir plus de 24
heures. C'est pour toutes ces raisons que les réservoirs
sont en général sur-dimensionnés. |
| |
|
|
 Réservoirs du Brugeron et de l'Arbre l'un à
côté de l'autre
Réservoirs du Brugeron et de l'Arbre l'un à
côté de l'autre |
|
|
| |
Les réservoirs semi-enterrés
sont toujours construits sur des points hauts au-dessus des habitations
à desservir en eau ceci afin d'avoir de la pression dans
les tuyaux. On compte environ une pression de 1 bar (ou 1kg/cm2)
pour une hauteur d'eau de 10 mètres. Ce qui signifie qu'une
maison située 30 mètres plus bas que le réservoir
qui l'alimente aura une eau à 3 bars de pression au niveau
de ses robinets.
Tous les réservoirs semi-enterrés
sont à peu près constitués des mêmes
éléments qui sont :
1 - une chambre de visite : appelée
également chambre sèche ou chambre de vannes, c'est
la partie du réservoir où les agents peuvent venir
faire des prélèvements d'eau, contrôler les
compteurs généraux ou inspecter le niveau du réservoir.
Pour des raisons d'hygiène et de sécurité,
il est impératif de rester dans cette partie du réservoir
pour ne pas contaminer l'eau stockée. La chambre de visite
contient tous les appareils hydrauliques nécessaires au bon
fonctionnement du réservoir à savoir le compteur d'eau,
les vannes de sectionnement, la ventouse automatique, le réducteur
de pression, etc. La vidange de la réserve se fait également
au niveau de la chambre de visite dans un puisard prévu à
cet effet. Ce puisard permet aussi d'évacuer l'eau nécessaire
au nettoyage de la chambre de visite. C'est aussi dans la chambre
de visite qu'arrive et parte les conduites d'arrivée et de
départ d'eau. C'est également en haut de la chambre
de visite que se trouvent les aérations permettant d'assécher
l'air du réservoir et d'éviter ainsi la condensation
sur les murs. |
| |
|
|
|
|
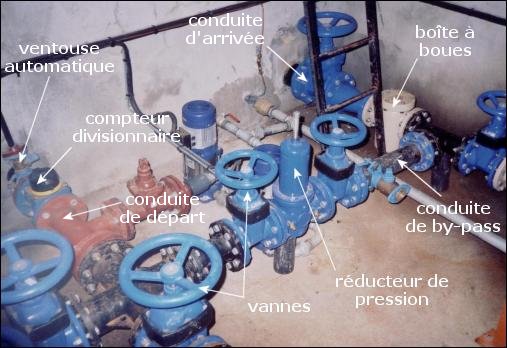 Chambre de visite du réservoir du Bouy : vannes,
compteur, ventouse, boîte à boues, réducteur
de pression et conduites d'arrivée et de départ
Chambre de visite du réservoir du Bouy : vannes,
compteur, ventouse, boîte à boues, réducteur
de pression et conduites d'arrivée et de départ |
|
|
| |
2 - une conduite
d'arrivée d'eau : cette conduite provient soit d'un captage,
on dit alors qu'il s'agit d'une conduite d'adduction d'eau, soit
d'un autre réservoir. Elle est généralement
d'un plus gros diamètre que la conduite de départ
d'eau et monte jusqu'au sommet de la réserve pour l'alimenter
en eau. Dans un réservoir, la réserve est toujours
remplie par le haut, l'eau tombe dans le réservoir. Cette
canalisation est facile à reconnaître car elle est
le plus souvent equipée d'une boîte à boue,
d'un réducteur de pression et d'une vanne de sectionnement.
Il n'y a généralement pas de compteur sur la conduite
d'arrivée d'eau. Il peut y avoir plusieurs conduites d'arrivée
d'eau dans un réservoir.
3 - une conduite de départ d'eau
: l'eau part en distribution par cette conduite. Contrairement à
la conduite d'arrivée d'eau qui monte au sommet de la réserve,
la conduite de départ d'eau part du fond de la réserve.
Elle est toujours équipée d'un compteur divisionnaire
afin de connaître la consommation des abonnés. La plupart
du temps, elle est également équipée d'une
ventouse automatique pour faire échapper l'air emprisonné
dans la canalisation. Elle est évidemment équipée
d'une vanne de sectionnement pour interrompre la distribution d'eau
en cas de problème. A noter qu'il existe une conduite, appelée
conduite de by-pass, entre la conduite d'arrivée et la conduite
de départ d'eau, équipée généralement
de deux vannes et d'un réducteur de pression, qui permet
d'alimenter la conduite de départ d'eau par la conduite d'arrivée
sans passer par la réserve, ce qui est très utile
lors du nettoyage de la réserve pour vider cette dernière
sans interrompre la distribution d'eau. Il peut y avoir plusieurs
conduites de départ d'eau dans un réservoir suivant
les besoins.
4 - un compteur : il y a systématiquement
un compteur divisionnaire (appelé également compteur
général ou compteur de sectorisation) sur la conduite
de départ d'eau pour connaître la consommation des
abonnés. Avec les techniques actuelles, ce compteur est généralement
équipé de la télégestion
ce qui permet d'en lire l'index depuis un ordinateur situé
dans les locaux administratifs. En revanche, il n'y a pas obligatoirement
un compteur sur la canalisation d'arrivée d'eau.
5 - plusieurs vannes : ces vannes permettent
d'interrompre l'arrivée de l'eau dans le réservoir
ou le départ de l'eau en distribution. S'il y a une conduite
de by-pass, d'autres vannes s'ajoutent pour ouvrir ou fermer le
by-pass. En général, on ajoute également des
vannes de part et d'autre des appareils hydrauliques. Enfin, il
y a une vanne permettant de vidanger le réservoir située
au-dessus du puisard.
6 - une boîte à boue : ou
filtre horizontal, cet appreil hydraulique est utilisé dans
le cas où l'eau d'arrivée provient d'un captage (on
parle alors d'adduction d'eau). Il s'agit en fait d'un filtre en
inox dans un corps en fonte. La boîte à boue est toujours
placée avant le compteur divisionnaire et les appareils de
régulation ou de pompage. Elle permet de retenir d'éventuels
débris qui seraient restés dans l'eau captée
et ainsi de protéger le compteur situé en aval d'elle.
Il s'agit d'un dégrillage sommaire de l'eau. La cartouche
filtrante de la boîte à boue doit être régulièrement
nettoyée. Le schéma suivant vous explique comment
est construit une boîte à boue : |
| |
|
|

Principe de fonctionnement d'une boîte à
boue
Modèle : FILTRAM CM (Ramus
Industrie)
|
|
|
| |
7 - un régulateur
de pression : en arrivant dans le réservoir, l'eau peut
provenir soit d'un captage soit d'un autre réservoir situé
plusieurs dizaines de mètres au-dessus de l'ouvrage. Cette
eau acquiert donc une pression telle qu'elle peut endommager les
différents appareils hydrauliques comme les compteurs ou
les boîtes à boue. Il faut donc pour cela atténuer
la "force" de l'eau en réduisant sa pression. Pour
cela, un régulateur de pression (appelé aussi réducteur
ou stabilisateur de pression) est composé d'une membrane
et d'un gros ressort qui vont "appuyer" sur l'eau pour
la freiner. Ce genre d'appareil est réglable et permet de
maîtriser la pression de l'eau en amont et en aval du réducteur
de pression. Pour plus de renseignements sur cet appareil, vous
pouvez consulter la page dic'eau,
au mot pression, ou la page consacrée aux autres
ouvrages.
8 - une ventouse automatique : on est amené
parfois à vider une canalisation lors d'une fuite par exemple.
Ceci a pour conséquence de faire pénétrer de
l'air dans la conduite. Cet air n'a qu'un seul choix pour s'échapper
de la canalisation : remonter jusqu'à son extrémité.
Mais il arrive que la conduite comporte sur son trajet des points
hauts et des points bas comme dans une montagne russe, l'air reste
alors bloqué dans les points hauts et ne peut plus s'échapper
de la canalisation. La solution est d'installer une ventouse automatique
au niveau de tous les points hauts ce qui va permettre à
l'air de s'évacuer naturellement. On dit qu'il dégaze.
Cet appreil est constitué principalement d'une bille, qui
joue le rôle de flotteur, et d'un trou pour l'échappement
de l'air. Lorsque la conduite est pleine d'eau, la bille est plaquée
contre le trou par l'eau. Dès qu'une bulle d'air arrive dans
la ventouse, la bille retombe et laisse s'échapper l'air
par le trou puis l'eau revient plaquer la bille contre le trou.
C'est donc pour cela que des ventouses automatiques sont installées
sur les conduites de départ d'eau dans les réservoirs,
elles servent à évacuer l'air contenu dans la canalisation
de distribution, le réservoir constituant le point haut de
la conduite. Les schémas suivants vous montrent comment fonctionnent
les ventouses automatiques : |
| |
|
|
|
|
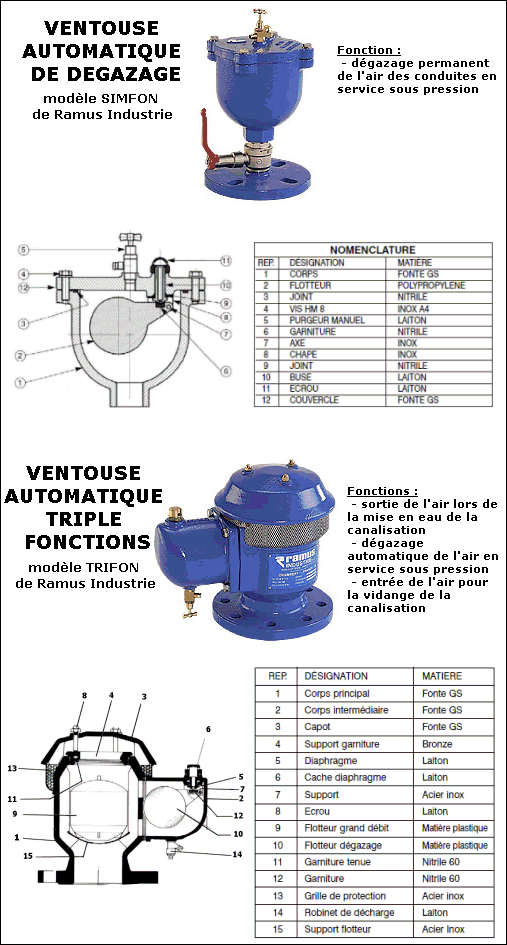 Principe de fonctionnement des ventouses automatiques
Principe de fonctionnement des ventouses automatiques
2 modèles : SIMFON et TRIFON (Ramus
Industrie) |
|
|
| |
9 - une réserve
d'eau : que serait un réservoir sans sa réserve!
La réserve est l'autre partie du réservoir bien distincte
de la chambre de visite, c'est elle qui contient l'eau. Cette dernière
arrive par le haut de la réserve, apportée par la
conduite d'arrivée. Elle passe par un robinet fermé
par un flotteur. Au fond de la réserve se trouve la vidange
et la canalisation de départ en distribution dont l'extrémité
est équipée d'une crépine. La majorité
des réservoirs de plus de 100 m3
de capacité sont équipés d'une cheminée
d'aération à leur sommet afin d'éviter tout
phénomène de condensation.
10 - une aération : pour éviter
la condensation de l'eau sur les parois du réservoir, ce
qui aurait pour conséquence la dégradation du béton,
les réservoirs sont équipés d'aération.
Ils sont d'abord équipés de grilles d'aération
situées en haut de la chambre de visite. Ces trous dans les
murs sont protégés par des grilles moustiquaires à
mailles très fines pour éviter la pénétration
des petits insectes. Enfin, les plus gros réservoirs sont
dotés d'une cheminée d'aération au sommet de
leur réserve afin d'assécher l'air ambiant de l'ouvrage.
11 - un accés : soit par un capot
en fonte pour les plus petits réservoirs, soit par une porte
métallique pour les plus grands ouvrages. Ces deux éléments
doivent être étanchéifiés par des joints
pour inviter toute intrusion d'insectes.
12 - une vidange : pour nettoyer le réservoir
et sa réserve il faut au préalable vider le contenu
de l'ouvrage. Pour cela, une vanne située dans la chambre
de visite et au pied de la réserve permet de vider cette
dernière. Comme un siphon au fond d'un évier, un trou
au fond de la réserve permet d'évacuer cette eau.
Le sol de la réserve est fait de telle manière que
l'eau s'écoule naturellement vers cette vidange.
13 - un trop-plein : il peut arriver que
le réservoir déborde lorsque ce dernier reçoit
plus d'eau qu'il n'en distribue ou que le robinet de fermeture ne
soit pas assez obturé. Pour éviter que l'eau ne passe
par dessus le mur de la réserve et ne se retrouve dans la
chambre de visite, l'ouvrage est muni d'un trop-plein. Il s'agit
d'un tuyau en fonte d'assez large section qui longe la paroi interne
de la réserve. La hauteur de ce tuyau est légèrement
inférieur de quelques centimètres à la hauteur
de la réserve ce qui fait que lorsque l'eau monte trop haut
dans l'ouvrage elle tombe par surverse dans le tuyau de trop-plein.
L'eau est ensuite dégagée par le puisard de la chambre
de visite et évacuée en dehors du captage.
14 - une crépine : la crépine
se fixe à l'entrée de la canalisation qui part de
la réserve pour alimenter les consommateurs. Elle s'installe
à l'intérieur de la réserve. Il s'agit d'une
pièce en plastique, parfois en aluminium, qui a pour but
d'arrêter d'éventuels débris, comme des brindilles
par exemple, avant qu'ils n'entrent dans la canalisation. La crépine
est une sorte de gros filtre qui effectue un dégrillage sommaire
sur l'eau.
15 - un robinet et un flotteur de fermeture
: à quoi sert de stocker de l'eau dont on a pas besoin? Lorsque
le réservoir est plein, l'eau transportée par la conduite
d'arrivée continue à couler dans la réserve
et part à l'extérieur de l'ouvrage par le tuyau de
trop-plein. Pour éviter un tel gâchis et pour essayer
de ponctionner le moins possible les ressources naturelles, un robinet
équipé d'un flotteur permet d'interrompre l'arrivée
de l'eau dans le cas où le réservoir est plein. Pour
être plus exact, ce système se ferme au fur et à
mesure que le niveau de l'eau s'élève dans la réserve.
Plus le niveau de l'eau est élévé et plus le
débit de la canalisation d'arrivée est réduit
par le robinet. Voilà à quoi ressemble ce procédé
: |
| |
|
|
|
|
 Réservoir du Bouy : arrivée de l'eau dans
la réserve, robinet, flotteur
Réservoir du Bouy : arrivée de l'eau dans
la réserve, robinet, flotteur
et trop-plein |
|
|
| |
Le flotteur suit le niveau de l'eau
dans la réserve. Au fur et à mesure qu'il sélève,
il obture le robinet qui arrête l'arrivée d'eau dans
le réservoir. Lorsque la consommation d'eau reprend (par
la conduite de départ située au fond du réservoir),
le niveau de l'eau baisse, le flotteur descend ce qui entraîne
l'ouverture du robinet. En réalité, la circulation
de l'eau est constante dans un réservoir. Elle arrive par
le sommet et repart par le fond en permanence. Le flotteur monte
et descend constamment.
16 - un clapet anti-retour en sortie de vidange
: toujours pour empêcher l'intrusion d'insectes ou de petits
animaux dans le réservoir, la sortie de la vidange située
à l'extérieur du réservoir doit être
équipée d'un clapet anti-retour muni d'un joint en
caoutchouc. Cette sortie permet d'évacuer l'eau du réservoir
lorsque celui-ci est vidangé ou lorsque l'eau déborde
par le trop-plein ou lorsque l'on nettoie la chambre de visite et
que l'eau s'évacue par le puisard. Fortement recommandés
par les services de l'A.R.S. Auvergne-Rhône-Alpes, ces petits
clapets sont malheureusement difficiles à trouver dans le
commerce.
Le schéma suivant vous permettra de mieux comprendre
le fonctionnement d'un réservoir et de ses différents
éléments : |
|
|
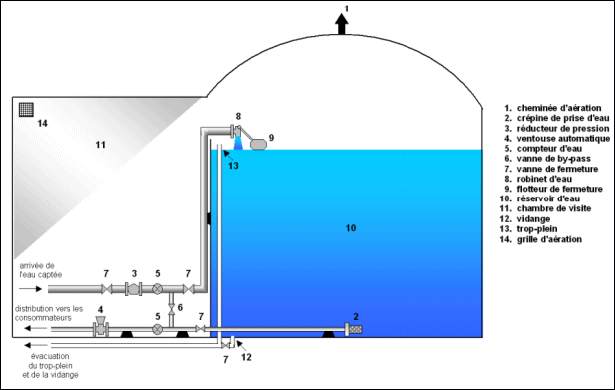
Schéma de fonctionnement d'un réservoir |
| |
|
|
| |
Voici la liste complète
des 27 réservoirs du réseau de distribution
d'eau potable du Syndicat de La Faye. Ces derniers sont classés
suivant la commune où ils se situent. Vous pouvez cliquer
sur leur nom pour consulter leur fiche signalétique.
Sur la commune du Brugeron
:
01 - Réservoir de l'Arbre
02 - Réservoir du Brugeron
03 - Réservoir du Chalard
Sur la commune de la Renaudie
:
04 - Réservoir du Garret
Sur la commune d'Augerolles
:
05 - Réservoir de Giroux-Vieux
06 - Réservoir du Trévy
07 - Réservoir de La Roche
08 - Réservoir de La Croix Rouge
09 - Réservoir du Poyet Haut
10 - Réservoir des Sagnes
Sur la commune de Saint-Gervais-sous-Meymont
:
11 - Réservoir du Bouy
Sur la commune de Sauviat
:
12 - Réservoir de Piboulet
13 - Réservoir de Lastioulas
Sur la commune d'Aubusson
d'Auvergne :
14 - Réservoir d'Aubusson d'Auvergne
Sur la commune d'Olmet
:
15 - Réservoir de Chamaly
16 - Réservoir de Mauzun
Sur la commune d'Olliergues
:
17 - Réservoir de Beaufrias
18 - Réservoir de la Bourboulhouse
19 - Réservoir d'Olliergues
20 - Réservoir du Mas
21 - Réservoir de Giroux-Gare
Sur la commune de Courpière
:
22 - Réservoir de Roddias
23 - Réservoir de Paris-les-Bois
Sur la commune de la Chapelle-Agnon
:
24 - Réservoir de Lafont
25 - Réservoir du Fraisse
Sur la commune de Saint-Amant-Roche-Savine
:
26 - Réservoir de La Fayolle
27 - Réservoir du bourg de Saint-Amant-Roche-Savine |
|
|
|



