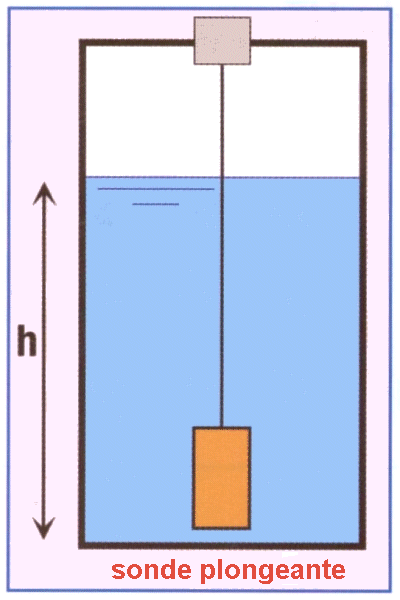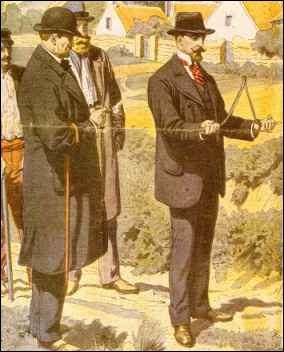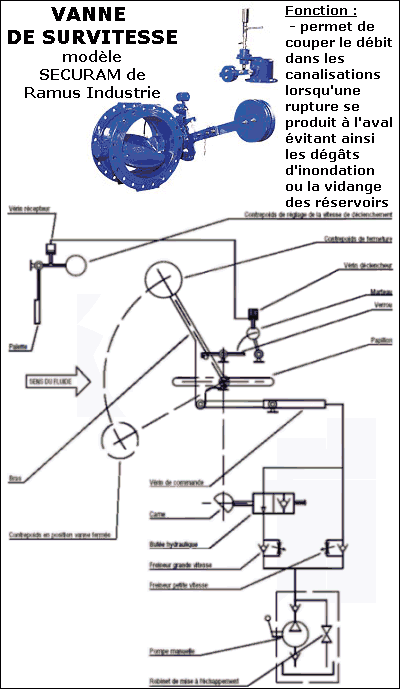|
| |
| En vous baladant sur ce site,
vous pouvez tomber sur un mot dont vous ne comprenez pas très
bien le sens. Heureusement, le Dic'eau est là pour vous aider!
Cliquez sur un des liens ci-dessous pour aller directement à
la lettre par laquelle commence le mot qui vous pose problème. |
| |
|
|
| |
|
|
| |
S.A.G.E. : voir schéma
d'aménagement et de gestion des eaux.
Saprophyte : se dit de toute bactérie qui
vit dans l'organisme sans être pathogène.
Par exemple, les Streptocoques fécaux sont des germes saprophytes
qui vivent dans l'intestin de l'homme et des animaux, ils ne sont
pas considérés comme pathogènes.
Saturation : moment où un liquide ne peut plus contenir
(dissoudre) une autre substance.
Saturnisme : intoxication aiguë ou chronique par le
plomb ou par ses dérivés.
Saveur : sensation produite par certains corps sur
l'organe du goût.
Schéma d'aménagement et de gestion des eaux
: il a pour but d'engager une gestion qui tend à
concilier de façon équilibrée la satisfaction
des différents usages avec la protection et la mise en valeur
des écosystèmes aquatiques sur un périmètre
déterminé. Les objectifs principaux d'une telle démarche
sont d'améliorer la qualité des eaux et de sauvegarder
des espèces animales et végétales. Une gestion
concertée sur l'ensemble du bassin versant permet d'avoir
une coordination technique et financière entre tous les usagers
de l'eau, et d'instaurer durablement une culture commune de l'eau.
Le S.A.G.E. est élaboré par une
Commision Locale de l'Eau
(C.L.E.) présidée par un élu. Les études
nécessaires à un S.A.G.E. peuvent être prises
en charge et financée par des partenaires publics (collectivités,
agence de l'eau, Etat) et des organismes associatifs ou professionnels.
La C.L.E., qui n'est pas un maître d'ouvrage, est un centre
d'animation, de débat et d'arbitrage. A l'issue de sa préparation,
le S.A.G.E. est approuvé par arrêté préfectoral
aprés une phase de consultation. Toutes les décisions
prises dans le domaine de l'eau par les services de l'Etat et les
collectivités publiques devront alors être compatibles
avec le S.A.G.E. mais il n'est pas opposable
aux tiers.
Le S.A.G.E. devient la référence
obligatoire pour lm'application de la réglementation. Il
identifie les priorités pour atteindre les objectifs qu'il
a fixés, les maîtres d'ouvrage possibles et évalue
les moyens économiques et financiers nécessaires.
La C.L.E. suit la mise en oeuvre du S.A.G.E. et les résultats
obtenus sur l'eau et les milieux aquatiques et en rend compte chaque
année. Enfin, le S.A.G.E. doit respecter les dispositions
prévues par le S.D.A.G.E..
Schéma de cohérence territoriale : le
S.Co.T. prévoit à l'échelle de plusieurs communes
(généralement regroupées en communauté)
les orientations des Plans
Locaux d'Urbanisme (P.LU.) spécifiques à chaque
commune. Il s'agit d'un document de planification créé
par la loi S.R.U.. Il remplace le schéma
directeur d'aménagement et d'urbanisme et a pour objectif
de renforcer la cohérence entre les politiques d'habitat,
d'urbanisme, de développement économique et de transport
tout en respectant les principes du développement durable.
Concrètement, le S.Co.T. identifie les espaces
réservés aux nouveaux logements, entreprises et aménagements
publics (routes, crêches...) en localisant les parcelles cadastrales
desservies ou non par les réseaux divers (eau, assainissement,
électricité, télécommunications...).
Le périmètre du S.Co.T. est validé
par le Préfet, représentant de l'Etat, et doit être
révisé tous les 10 ans. Il se compose d'un rapport
de présentation (diagnostic) et d'un document d'orientation
précisant les objectifs à atteindre en terme d'organisation
de l'espace.
Schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux : créé par la loi sur l'eau de 1992
et officiellement entré en vigueur en 1997, il trace les
orientations d'une politique nouvelle de l'eau. Son principe consiste
à établir des priorités fortes à l'échelle
des six grands bassins versants
français : Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne,
Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée-Corse et Seine-Normandie
(il n'y a donc que six S.D.A.G.E. en France). Les services de l'Etat,
les collectivités territoriales et leurs établissements
publics doivent en tenir compte pour toutes leurs décisions
concernant l'eau et les milieux aquatiques. Ce schéma directeur
coordonne et oriente les initiatives locales de gestion collective
: S.A.G.E., contrats de rivières, contrats
littoraux, plans d'actions.... Il favorise ainsi la complémentarité
des actions sur le terrain et la convergence des dépenses
publiques sur des objectifs communs.
Les priorités du S.D.A.G.E. visent une
gestion équilibrée. La stratégie des S.D.A.G.E.
consiste à concilier le développement équilibré
des différents usages de l'eau avec la protection de ce patrimoine
commun.
S.Co.T. : voir Schéma de Cohérence
Territoriale.
S.D.A.E.P. : Syndicat Départemental d'Alimentation
en Eau Potable.
S.D.A.G.E. : voir schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux.
Sécheresse : période prolongée
pendant laquelle on ne note pas ou peu de précipitations,
elle est un phénomène accidentel, de périodicités
et de durées variables, due à un déficit plus
ou moins prononcé des précipitations. Il ne faut pas
confondre à l'aridité. Celle-ci est un phénomène
permanent pendant des périodes très longues. Elle
est le propre d'un bon tiers des terres et affecte environ 15 %
de la population mondiale.
Sectorisation du réseau : elle consiste à
subdiviser le réseau en plusieurs zones distinctes de par
leur implantation géographique et la configuration de la
distribution. Les zones ainsi définies sont constituées
à leur entrée par un ou plusieurs compteurs d'eau
divisionnaires (placés dans des regards en des points stratégiques
du réseau) et à leur sortie par zéro ou plusieurs
compteurs divisionnaires. La différence entre les volumes
d'eau mesurés à l'entrée d'une zone et à
la sortie correspond à la consommation d'eau par les abonnés
situés dans cette zone. La sectorisation du réseau
permet de prélocaliser les fuites d'eau sur le réseau.
Cette technique ne fonctionne que sur les réseaux ramifiés
comme c'est le cas au Syndicat de la Faye.
Sécurité d'alimentation en eau potable :
ensemble des mesures internes à une unité de distribution
(système A.E.P.)
visant à alimenter les usagers dans des situations critiques
ou de crise (pollution accidentelle de la ressource, pénurie
d'eau, intrusion par infraction dans un réservoir...) : interconnexions
de réseaux, recours à des ressources d'eau différentes...
Ces solutions de secours à mettre en oeuvre
doivent être énumérées dans le plan de
secours spécialisé élaboré par l'administration
départementale. Par extension, il s'agit d'être capable
d'assurer l'approvisionnement en eau potable des populations dans
toutes les circonstances.
Sédimentation : dépôt des matières
en suspension ou en dissolution dans un liquide.
S.E.M.A. : Service de l'Eau et des Milieux Aquatiques.
Service public de l'assainissement non collectif :
le S.P.A.N.C. est un outil instauré par la loi sur l'eau
de 1992. Les communes doivent gérer le S.P.A.N.C. depuis
le 31 décembre 2005. Il a pour objectifs d'assister et de
conseiller les particuliers, de sensibiliser le grand public et
de contrôler les dispositifs neufs ou existants (fosses sceptiques,
épandages). Pour cela, les personnes responsables du S.P.A.N.C.
émettent un avis sur les projets des particuliers et la conformité
de leurs dispositifs. Ils réalisent un zonage d'assainissement
de la commune, ce qui permet d'identifier les zones d'assainissement
non collectif, puis ils iindiquent les filières de traitement
à mettre en oeuvre.
Le S.P.A.N.C. ne s'occupe que du contrôle
des installations d'assainissement non collectif mais ne se charge
pas de la réalisation, de la réhabilitation ou de
l'entretien des fosses sceptiques. Le financement de ce service
est assuré par une redevance annexée à la facture
d'eau dans les communes ayant mis un S.P.A.N.C..
Servitude : charge ou contrainte imposée sur
une propriété pour l'usage ou l'utilité d'une
autre qui n'appartient pas au même propriétaire. Dans
le cadre de la procédure de périmètre
de protection, il s'agit de contraintes visant à protéger
la ressource en eau en limitant les activités polluantes
comme l'agriculture ou l'industrie.
S.I.A.E.P. : Syndicat Intercommunal d'Alimentation
en Eau Potable.
S.I.E.A. : Syndicat Intercommunal Eau et Assainissement.
Siphon : tube recourbé utilisé pour
transvaser un liquide et le faire passer d'un niveau à l'autre
plus bas en l'élevant d'abord au-dessus du niveau le plus
haut.
S.M.E.A. : Syndicat Mixte Eau et Assainissement.
Sodium : métal alcalin blanc et mou très
répandu dans la nature à l'état de chlorure
(sel marin) et de nitrate.
Solidarité et renouvellement urbain : la loi
S.R.U. du 13 décembre 2000 a pour but de répondre
au problème que les villes d'aujourd'hui sont différentes
de celles d'il y a 50 ans. Cette loi veut lutter contre la péri-urbanisation
et le gaspillage de l'espace en favorisant le renouvellement urbain.
Cette loi offre aux décideurs publics un cadre juridique
pour développer l'urbanisme, elle comporte trois volets qui
sont :
- l'urbanisme : l'objectif est de rénover
les documents d'urbanisme avec le Schéma
de Cohérence Territoriale (S.Co.T.) qui encadre les Plans
Locaux d'Urbanisme (P.L.U.). La loi S.R.U. oblige à une
concertation avec la population.
- l'habitat : l'objectif de ce volet de
la loi S.R.U. est de renforcer la solidarité entre les villes
en imposant par exemple 20% de logements sociaux et de lutter contre
l'insalubrité dans l'habitat.
- le déplacement : l'objectif est
d'harmoniser les déplacements et les transports en cohérence
avec le principe de développement durable. Ce volet de la
loi autorise les communes à se regrouper pour gérer
les transports et elle confie aux régions l'organisation
des services ferroviaires régionaux.
La loi S.R.U. a été modifiée
le 2 juillet 2003 par la loi Urbanisme
et habitat (U.H.) qui a modifié, entre autre, l'opposabilité
du Projet d'Aménagement et de Développement Durable
(P.A.D.D.) et instauré la Participation pour Voirie et Réseaux.
Solidification : passage de l'état liquide
à l'état solide.
Solubilité : plus ou moins grande facilité
avec laquelle un corps se dissout dans l'eau.
Solution : liquide dans lequel se trouve dissoute
une substance solide.
Solvant : substance qui a le pouvoir de dissoudre
d'autres substances.
Sonde de niveau : appareil permettant de mesurer le
niveau d'eau dans un réservoir. Il en existe de deux sortes
: les sondes de niveau à ultrasons et les sondes de niveau
piézométrique. Les sondes de niveau à ultrasons
mesurent le temps de parcours de l'onde ultrasonore réfléchie
sur la surface de l'eau. Les sondes de niveau piézométrique
détectent des variations de niveau d'eau dans les réservoirs
à l'aide de capteur de pression constitué d'une membrane
élastique se déformant sous l'effet de la pression.
Chacun de ces deux types de sondes transforme leur mesure en grandeur
électrique qui est ensuite rapatriée vers les enregistreurs
de la télégestion.
SONDE DE NIVEAU A
ULTRASONS

|
SONDES DE NIVEAU
PIEZOMETRIQUE
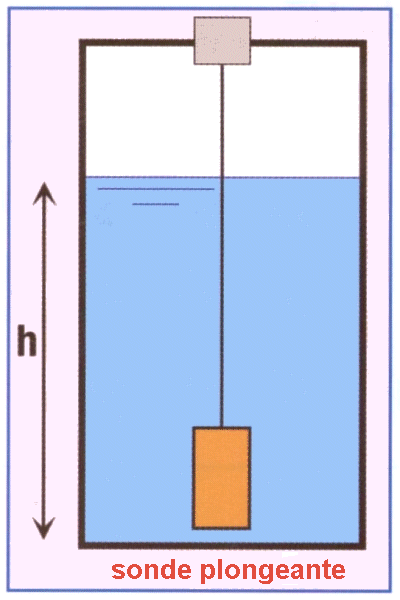
|
Source : terme générique qui désigne
l'émergence naturelle d'une eau souterraine en surface ou
en sous-sol.
Sourcier : personne capable de détecter la
présence de courants d'eau souterrains (et parfois même
leurs débits) grâce à la radiesthésie.
|
|
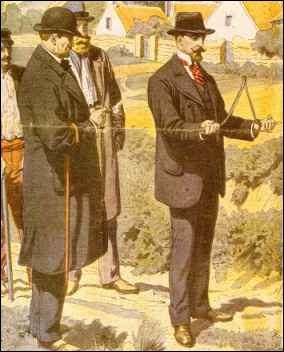 Le sourcier radiesthésiste
Le sourcier radiesthésiste |
|
Sous-solage : opération pratiquée par
les forestiers consistant à casser la structure profonde
du sol à l'aide d'une dent pour faciliter l'aération
et le drainage naturel d'un terrain.
S.P.A.N.C. : voir Service Public de l'Assainissement
Non Collectif.
Sprinklers : asperseurs montés au plafond sur des
rampes servant à la protection incendie dans des lieux publics,
magasins ou entrepôts.
S.R.U. : voir la loi sur la Solidarité
et le Renouvellement Urbain.
Stabilisateur d'écoulement : tranquilise l'écoulement
de l'eau pour une bonne métrologie (compteur Woltmann axial).
Stabilisateur de pression : voir pression.
Station d'épuration : une station d'épuration
est installée généralement à l'extrémité
d’un réseau d’assainissement ou de collecte des
eaux usées. Elle rassemble une succession de dispositifs
dont chacun est conçu pour extraire au fur et à mesure
les différents polluants contenus dans les eaux. Les eaux
épurées retournent ensuite dans le milieu naturel.
Station de jaugeage : installation de mesure du niveau
de l'eau grâce à des appareils enregistreurs de hauteur
d'eau.
Station météorologique : c'est le lieu
où l'on recueille à l'aide d'instruments très
précis des informations permettant de prévoir le temps,
et des données pour caractériser le climat du lieu.
Stockage : au cours d'une journée ordinaire,
la consommation d'eau, comme celle d'électricité,
passe par des hauts et des bas. La vie sociale impose ses rythmes.
Il y a des heures intenses où, comme un seul homme, toute
une population fait sa toilette ou sa cuisine, et des heures creuses
durant lesquelles la demande est presque nulle. A quatre heures
du matin les robinets sont fermés et les égoûts
sont vides.
Or, l'eau potable est "produite" de
manière à peu près constante. Qu'elle provienne
des captages de nappes ou des usines qui traitent l'eau de rivière,
les conduites l'amènent de façon régulière,
sans à-coups. Il est donc nécessaire d'installer des
réservoirs tout au long du réseau de distribution
si l'on veut éviter les coupures. On s'efforce toujours de
les installer sur les points hauts. L'eau y est ainsi maintenue
en pression par le simple effet de la gravité. En cas de
panne de courant, qui rendrait les pompes inopérantes, le
service ne s'interrompra pas. S'il n'existe pas de points hauts,
on les perche sur une tour, clous mal enfoncés plantés
dans le paysage et on les appelle châteaux d'eau.
Dans les villes alimentées exclusivement
par de l'eau de rivière, la distribution souffre d'une fragilité
supplémentaire. Qu'une péniche chargée de produits
toxiques chavire ou qu'un camion se renverse sur les berges, et
la matière première de l'usine de traitement est inutilisable.
Aussi procède-t-on aujourd'hui par double stock : à
l'amont de l'usine avec des eaux non encore traitées et à
l'aval de l'usine avec de l'eau potable.
Strate : étage de végétation
défini par une fourchette de hauteur.
Stratus : nuage qui s'étale en couche.
Stripping : procédé de transfert liquide/gaz
utilisé dans le traitement
de l'eau potable qui permet de faire transférer, par mise
en contact de l'eau à traiter avec un flux d'air, des micropolluants
organiques volatils de la phase liquide dans la phase gazeuse. Ce
procédé est employé pour éliminer les
composés organochlorés : le 1-2-dichloroéthane,
le trichloroéthylène, le tétrachloroéthylène,
le chloroforme... Il peut également contribuer à diminuer
l'odeur de l'eau en agissant sur les composés cités
ci-dessus ou sur d'autres porduits odorants, volatils et relativement
insolubles dans l'eau ayant un seuil olfactif bas comme des composés
soufrés, aminés, carbonylés ou des hydrocarbures.
Deux techniques sont possibles : l'insufflation de fines bulles
d'air dans l'eau comme dans le procédé de flottation
ou le passage de l'eau dans une colonne d'air.
Sublimation : transformation de la glace en vapeur
d'eau.
Substance à risque toxique : substance qui,
à certaines concentrations dans l'eau, présente un
risque pour la santé publique, la santé animale ou
pour des êtres vivants et des écosystèmes en
général. Certaines substances et leurs effets sont
relativement bien identifiés (métaux
lourds, certains micropolluants).
Pour d'autres, le risque pour la santé publique et les écosystèmes
est difficile à apprécier, ce qui conduit par prudence
à recourir au principe
de précaution. On parle ainsi de "risque toxique".
Surpresseur : pompe spéciale que l'on ajoute
dans un circuit ou un réseau d'alimentation en eau potable
pour augmenter la pression.
La pompe est toujours accompagnée d'un ballon ou réservoir
hydropneumatique. Le surpresseur peut être à vitesse
fixe ou variable asservi au débit demandé ou à
la pression du réseau.
Surpression : c'est le fait de mettre en pression
un réseau à l'aide de pompes et de réservoirs
hydropneumatiques pour pouvoir alimenter tous les habitants
d'un immeuble.
Surverse : voir trop-plein.
Survitesse : se dit lorsque le débit
d'eau dans une conduite augmente trop rapidement (à cause
d'une fuite par exemple). Un état de survitesse peut avoir
des conséquences désastreuses sur un réseau
de distribution avec notamment la vidange des réservoirs.
Pour éviter ce phénomène, on peut utiliser
un appareil hydraulique appelé vanne de survitesse qui va
obturer la canalisation en cas de débit trop fort. Le fonctionnement
de cet appareil est simple. Une première partie constituée
d'une palette est installée en amont de la vanne de survitesse
et sert de servocommande. La deuxième partie est constituée
par la vanne elle même. Les deux parties sont reliées
entre elles par un tuyau flexible qui permet un transfert d'huile
afin de déclencher la fermeture de la vanne. Un fort débit
d'eau entraîne le basculement de la palette, un verrin hydraulique
déclencheur actionne alors un bras qui va fermer la vanne.
Le schéma suivant vous montre comment fonctionne cet appareil
:
|
|
Schéma de fonctionnement d'une vanne de survitesse
Modèle : SECURAM (Ramus
Industrie)
|
|
Suspension : solide séparé en petites
unités, mélangé à un liquide sans être
dissous par lui.
Syndicat : collectivité
territoriale et établissement
public de coopération intercommunale, le syndicat est
la plus ancienne forme de coopération intercommunale. Il
est géré de la même façon que toutes
les collectivités territoriales à savoir qu'il possède
une assemblée délibérante (le comité
ou le conseil) et une instance exécutive (le président
et ses vice-présidents). Les syndicats peuvent être
de plusieurs formes :
- les S.I.V.U. : Syndicats Intercommunaux
à Vocation Unique. Créés en 1890, ils ne peuvent
exercer qu'une seule compétence, ce qui est le cas du S.I.A.E.P.
de la Faye.
- les S.I.Vo.M. : Syndicats
Intercommunaux à Vocation Multiple. Créés dès
1959, ils peuvent exercer plusieurs compétences et les communes
ne sont pas obligées d'adhérer à toutes les
compétences.
- les Syndicats Mixtes : créés
en 1935, ils regroupent différents de collectivités
comme par exemple des communes avec des communautés de communes
ou des communes avec des départements. Il existe des syndicats
mixtes fermés regroupant uniquement des communes et des groupement
de communes, et des syndicats mixtes ouverts regroupant des communes
avec des régions ou des départements.
- S.A.N. : Syndicats d'Agglomération
Nouvelle : créés en 1983 pour résoudre les
problèmes d'urbanisation des grandes métropôles.
Il n'y en a que 6 en France.
Synoptique : représentation graphique et schématique
d'un réseau d'alimentation en eau potable. Vous pouvez visualiser
le synoptique du réseau du Syndicat de la Faye en cliquant
ici.
Système aquifère : ensemble de terrains aquifères
constituant une unité hydrogéologique. Ses caractères
hydrodynamiques lui confèrent une quasi indépendance
hydraulique (non-propagation d'effets en dehors de ses limites).
Il constitue donc à ce titre une entité pour la gestion
de l'eau souterraine qu'il renferme. |
| |
|
|
|