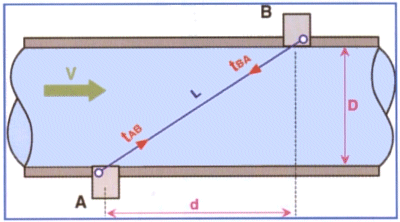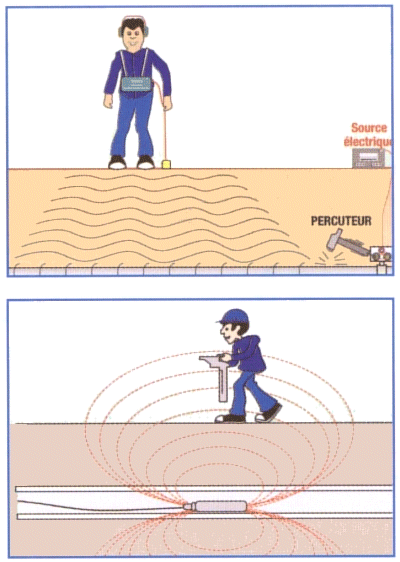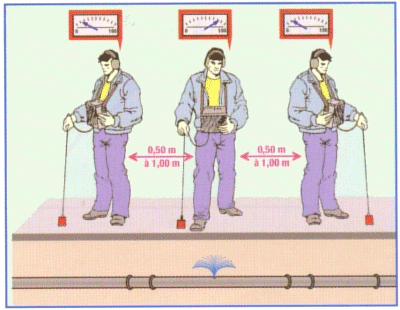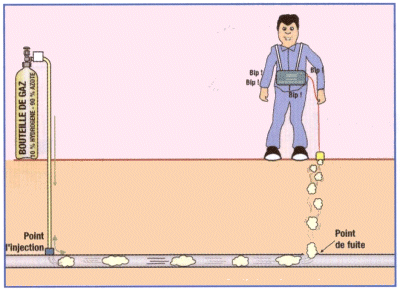|
| |
| En vous baladant sur ce site,
vous pouvez tomber sur un mot dont vous ne comprenez pas très
bien le sens. Heureusement, le Dic'eau est là pour vous aider!
Cliquez sur un des liens ci-dessous pour aller directement à
la lettre par laquelle commence le mot qui vous pose problème. |
| |
|
|
| |
|
|
| |
D.B.O. : Demande Biologique
en Oxygène. Voir normes
de l'eau.
D.C.E. : voir Directive Cadre sur l'Eau.
D.C.E. : voir Dossier de Consultation des
Entreprises.
D.C.O. : Demande Chimique en Oxygène. Voir normes
de l'eau.
D.C.R. : débit de crise, valeur de débit d'étiage
au-dessous de laquelle l'alimentation en eau potable pour les besoins
indispensables à la vie humaine et animale, ainsi que la survie
des espèces présentes dans le milieu sont mises en péril.
À ce niveau d'étiage, toutes les mesures possibles de restriction
des consommations et des rejets doivent avoir été mises en oeuvre
(plan de crise).
D.C.U. : débit de crue utile, débit des crues indispensables
à la vie du cours d'eau ainsi que de ses annexes, et qui n'a pas
d'effets intolérables (notamment vis-à-vis des zones habitées).
Les petites crues ont un rôle fondamental dans la dynamique de la
régénération des milieux, il ne faut pas chercher à les supprimer
ni à y soustraire les milieux.
D.D.A.F. : Direction Départementale de l'Agriculture
et de la Forêt, structure administrative chargée entre
autre d'effectuer les études d'ingénierie pour les
travaux effectués sur les réseaux d'eau potable des
communes rurales. La D.D.A.F. est un organisme déconcentré
de l'Etat qui effectue un contrôle des travaux menés
par les collectivités
territoriales. Le Syndicat de La Faye travaille systématiquement
avec un ingénieur du service ingénierie et territoires
de la D.D.A.F. pour ces travaux d'alimentation en eau potable.
D.D.A.S.S. : Direction Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales, aujourd'hui nommée A.R.S..
D.D.E. : Direction Départementale de l'Equipement.
Débit : volume d'eau qui traverse une
section transversale d'un cours d'eau par unité de temps.
Les débits des cours d'eau sont exprimés en m3/s
avec trois chiffres significatifs (exemple : 1,92 m3/s
ou 192 m3/s). Pour les petit cours
d'eaux, ils sont exprimés en l/s.
Les débits d'exploitation des eaux pour
les usages, comme la distribution de l'eau potable par exemple,
sont suivant les cas exprimés aussi en m3/min,
m3/h, m3/j
ou m3/an. Il en est de même
pour les débits d'eaux souterraines.
Débit affecté : d'après la loi sur l'eau de
1992, « lorsque des travaux d'aménagement hydraulique,
autres que ceux concédés ou autorisés en application ont pour objet
ou pour conséquence la régulation du débit d'un cours d'eau non
domanial ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, tout
ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration
d'utilité publique, sur une section de ce cours d'eau et pour une
durée déterminée, à certains usages ».
Débit contrôlé ou artificiel : débit
résultant des interventions humaines et tel que les écoulements
sont totalement perturbés : transferts effectués d’un
bassin à un autre au moyen de réseaux naturels aménagés et/ou artificiels.
Débit d'étiage d'un cours d'eau : voir étiage.
Débit de surcharge : débit le plus élevé
auquel le compteur fonctionne de façon satisfaisante pendant
une courte période sans détérioration.
Débit de transition : débit à partir
duquel un compteur d'eau doit respecter une erreur maximale de plus
ou moins 2%.
Débit influencé : débit d'un cours d'eau perturbé
du fait des interventions humaines mais tels que les écoulements
conservent leurs caractéristiques générales.
Débit maximal : c'est le débit limite à
ne pas dépasser sans risque de détériorer un
compteur d'eau. C'est également le débit au dessus
duquel la précision de mesure du compteur n'est plus garantie.
Il représente 2 fois le débit
nominal.
Débitmètre : appareil mesurant le débit.
Débitmètre à insertion : les
sondes à insertion calculent le débit dans les canalisations
sur la base d'une mesure de vitesse ponctuelle dans l'écoulement,
en utilisant le principe des débitmètres électromégnatiques
(loi de Faraday). Ce type d'appareil permet une mesure bidirectionnelle
avec une plage de vitesse de l'ordre de 0,1 m/s à quelques
m/s. La pose et la dépose de la sonde s'effectuent sans interruption
de la distribution au travers d'un collier de prise en charge. Le
capteur doit être installé à une certaine distance
de la paroi de la conduite selon les prescriptions du fabriquant.
DEBITMETRE ELECTROMAGNETIQUE
A INSERTION

|
Débitmètre à temps de transit :
ce débitmètre calcul la vitesse de l'eau grâce
à la mesure du temps mis par une onde ultrasonore pour traverser
la canalisation.
DEBITMETRE A DIFFERENCE
DE TEMPS DE TRANSIT
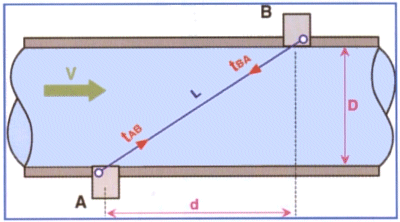
|
Débitmètre électromagnétique :
appareil mesurant le débit à l'aide d'une mesure de
potentiel. Le débitmètre génère, grâce
à une ou plusieurs paires de bobines, un champ magnétique
connu perpendiculaire à la direction de l'écoulement.
L'eau véhiculée traverse le champ magnétique
et crée donc une tension (loi de Faraday). Cette différence
de potentiel mesurée est directement proportionnelle à
la vitesse de l'eau dans la conduite. Les débitmètres
électromagnétiques peuvent être alimentés
par le secteur ou par des piles. Le diamètre nominal de l'appareil
doit être choisi de façon à avoir une vitesse
d'écoulement en fin d'échelle de l'ordre de 2 à
3 m/s.
DEBITMETRE ELECTROMAGNETIQUE
EN LIGNE

|
Débit minimal : valeur de débit maintenu à l'aval
d'un ouvrage localisé de prise d'eau (rivière court-circuitée,...)
en application de l'article L-232-5 du code rural (loi "Pêche").
Cet article vise explicitement les "ouvrages à construire dans le
lit d'un cours d'eau", et les "dispositifs" à aménager pour maintenir
un certain débit. Il oblige à laisser passer un débit minimal garantissant
la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent
les eaux. Ce débit minimal est au moins égal au dixième du module
(au 1/40ème pour les installations existantes au 29/06/84) ou au
débit entrant si ce dernier est inférieur. Le débit minimal est
souvent appelé, à tort, débit réservé.
Pour un compteur d'eau, le débit minimal correspond
au débit le plus faible auquel le compteur fournit des indications
qui permettent de respecter les erreurs maximales tolérées
(entre plus ou moins 5 % du débit réel).
Débit nominal : débit servant à désigner
un compteur d'eau froide. Il est égal à la moitié
du débit maximal. Au débit
nominal, l'usage a associé la notion de diamètre d'un
compteur :
- débit nominal de 1,5 m3/h diamètre
intérieur du compteur : 15 mm
- débit nominal de 2,5 m3/h diamètre
intérieur du compteur : 20 mm
- débit nominal de 3,5 m3/h diamètre
intérieur du compteur : 25 mm
- débit nominal de 5 m3/h diamètre
intérieur du compteur : 30 mm
- débit nominal de 10 m3/h diamètre
intérieur du compteur : 40 mm
- débit nominal de 15 m3/h diamètre
intérieur du compteur : 50 mm
- débit nominal de 20 m3/h diamètre
intérieur du compteur : 60 mm
Débit objectif d'étiage : valeur de débit
d'étiage en un point (au point nodal) au-dessus de laquelle il est
considéré que l'ensemble des usages (activités, prélèvements, rejets,...)
en aval est en équilibre avec le bon fonctionnement du milieu aquatique.
C'est un objectif structurel, arrêté dans les S.D.A.G.E., S.A.G.E.
et documents équivalents, qui prend en compte le développement des
usages à un certain horizon (10 ans pour le S.D.A.G.E.). Il peut
être affecté d'une marge de tolérance et modulé dans l'année en
fonction du régime (saisonnalité). L'objectif D.O.E. est atteint
par la maîtrise des autorisations de prélèvements en amont, par
la mobilisation de ressources nouvelles et des programmes d'économies
d'eau portant sur l'amont et aussi par un meilleur fonctionnement
de l'hydrosystème. Abréviation : D.O.E.
Débit permanent : débit le plus élevé
auquel le compteur fonctionne de façon satisfaisante dans
des conditions normales d'utilisation, c'est à dire dans
les conditions de débit constant ou intermittent.
Débit réservé : débit minimal éventuellement
augmenté des prélèvements autorisés sur le tronçon influencé. Il
est exprimé notamment dans les cahiers des charges et les règlements
d'eau. Souvent utilisé à tort à la place de débit minimal.
Déblai : par opposition à remblai,
terres, décombres que l'on retire d'un terrain.
Décantation : dépôt sous forme de boues
des matières en suspension dans l'eau.
Décarbonatation : méthode de traitement de
l'eau qui vise à réduire la dureté carbonatée
calcique (THCa) de l'eau par différentes méthodes
(précipitation par électrolyse, percolation sur résines
échangeuses d'ions, filtration par nanomembranes ou décarbonatation
chimique). C'est une technique de l'adoucissement
de l'eau.
Décentralisation : il s'agit du transfert aux collectivités
territoriales des compétences et des moyens de l'Etat,
lequel ne pouvant plus exercer de pouvoir hiérarchique à
leur encontre. Seuls des contrôles juridiques (via les préfectures)
et financiers (via le trésor public) sont maintenus. Un exemple
de compétences transférées aux collectivités
territoriales sont la gestion des déchets, de l'eau et des
transports.
Décision modificative : c'est un document facultatif
qui permet d'adapter le budget
primitif au cours de l'année afin que ce dernier reste
à l'équilibre. Contrairement au budget
supplémentaire, qui correspond à une ligne supplémentaire
dans le budget, dépenses imprévues ou recettes imprévues,
la décision modificative modifie une ligne du budget, correction
du montant d'une recette ou d'une dépense espérée.
Il peut y en avoir plusieurs au cours de l'année.
Déclaration administrative : procédure de police
obligeant les particuliers désireux de mettre en place des installations,
ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur les eaux
et les milieux aquatiques, à les déclarer à partir d'un certain
niveau (seuils de prélèvement, rejet, dimension des enclos piscicoles,
dragage, rectification du lit,...). Au delà d'un autre niveau supérieur,
ces activités doivent faire l'objet d'un acte d'autorisation.
Déclaration d'intention de commencement de travaux :
document envoyé par les entreprises travaillant sur un chantier
aux exploitants des différents réseaux enterrés
(eau potable, assainissement, électricité, télécommunications,
gaz, éclairage public, chauffage central) afin de demander
à ces derniers où se situent leurs réseaux.
Ce document sert également à prevenir les expoloitants
du futur chantier qui aura lieu. En général, les exploitants
contactés par D.I.C.T. ont été identifiés
au préalable lors de la D.R. faite par
le maître d'ouvrage
ou le maître d'oeuvre
auprès de la mairie. Une D.I.C.T. doit être envoyée
au moins 10 jours avant la date de début des travaux. Les
exploitants disposent de 9 jours à partir de la réception
de la D.I.C.T. pour répondre. Sans réponse de leur
part, les entreprises peuvent débuter les travaux 3 jours
après l'envoi d'une lettre de rappel.
Déclaration d'utilité publique : acte administratif
reconnaissant le caractère d'utilité publique à
une opération projetée par une personne publique ou
pour son compte, après avoir recueilli l'avis de la population
à l'issue d'une enquête d'utilité publique.
Cet acte est en particulier la condition préalable à
une expropriation (pour cause d'utilité publique) qui serait
rendue nécessaire pour la poursuite de l'opération
(comme la mise en place de périmètres de protection
autour des captages).
Déconcentration : il s'agit du transfert aux autorités
de l'Etat du pouvoir décisionnel de l'Etat tout en restant
sous son contrôle hiérarchique. Ainsi, les autorités
déconcentrées (comme la D.D.A.S.S.,
la D.D.A.F. ou la D.D.E.)
n'ont pas la libre administration ni une personnalité juridique
propre, contrairement aux collectivités
territoriales. Elles doivent exécuter les ordres de l'Etat
et rendre des comptes.
Décret : acte réglementaire signé soit
du Président de la République, soit du Premier Ministre.
Les décrets dits "décrets en Conseil d'Etat",
ne peuvent être pris qu'aprés consultation du Conseil
d'Etat.
Degré Celsius (°C) : les degrés
Celsius sont une échelle servant à mesurer la température
de l'eau, basée sur la température de fusion de l'eau
(0°C) et celle de sa vaporisation (100°C).
Degré chlorométrique : symbole °chl.
Unité française de Gay-Lussac. C'est le nombre de
litres de chlore gazeux susceptibles d'être dégagés
par un litre de solution ou d'extrait de solution dans les conditions
normales de température et de pression (0°C et 101,3
kPa). Il est égal au nombre de litres de chlore gazeux ayant
servi à fabriquer 1 litre de solution. Exemple : une solution
à 1°chl libère un litre de chlore gazeux. 1
°chl = 3,17 g/l de chlore libre. Voir également la
page sécurité
et la rubrique nettoyage des ouvrages pour plus de précisions.
Délégation de service : il y a délégation
du service public de l'eau lorsque la commune cède la gestion
de ce service à une société privée.
On parle dans ce cas de "gestion déléguée".
La délégation peut être totale ou partielle.
Le paiement du prestataire de la délégation de service
public est rémunéré en totalité ou en
partie par les résultats d'exploitation du service. Il existe
3 types de délégation de service public :
- la concession : elle a une durée
déterminée, le concessionnaire prend à sa charge
tous les frais du service et construit lui-même les ouvrages
utiles au service, il se rémunère par les redevances
des usagers du service.
- l'affermage : les ouvrages sont construits
par la collectivité
territoriale. Le fermier en assure l'entretien et l'utilisation,
il reçoit les redevances des usagers et en reverse une partie
à la collectivité territoriale. Le fermier est propriétaire
des ouvrages.
- la régie intéressée
: les ouvrages restent la propriété de la collectivité
qui procède au financement des constructions utiles au service.
Le régisseur (la société privée) est
rémunéré par une somme forfaitaire versée
par la collectivité territoriale suivant les résultats
d'exploitation.
Demande de renseignements : Demande de Renseignements.
Document demandé par le maître
d'ouvrage ou le maître
d'oeuvre à une mairie pour connaître l'emplacement
exact des réseaux enterrés (eau potable, assainissement,
électricité, télécommunications, gaz,
éclairage public, chauffage central) situés dans la
zone d'un futur chantier. La mairie doit donner une réponse
dans un délai de moins d'un mois. Ce document diot être
demandé systématiquement avant le début des
travaux. La D.R. a une validité de 6 mois.
Dénitrification : réduction des nitrates
(NO3-)
en azote gazeux (N2) par des bactéries
en situation d'anoxie (manque d'oxygène). Un milieu en anoxie
est tel que l'oxygène sous sa forme dissoute en est absent.
Ce phénomène est différent de la consommation
des nitrates par les végétaux et permet de dénitrifier
une eau brute en vue
de la production d'eau potable.
Densité : la densité est le rapport de
la masse d'un certain volume d'un corps à la masse du même
volume d'eau. Par exemple, la masse d'eau dans le corps humain représente
65% du poids total de l'adulte.
Département : collectivité
territoriale au même titre qu'une commune, les départements
ont été créés en 1790. Ils sont dirigés
par des conseils généraux dont les membres sont élus
par canton au suffrage universel et pour 3 ans. Ils élisent
en leur sein le président du conseil général.
Ce dernier dispose de pouvoirs (financement, police...) et rend
compte de l'activité du département au conseil général.
Les départements disposent d'attributions budgétaires,
d'attributions relatives aux services publics départementaux,
d'attributions relatives au personnel départemental, d'attributions
relatives aux biens et à l'aménagement du territoires
et d'attributions économiques. Leurs domaines de compétences
sont les suivants :
- hygiène et action sociale (enfance, handicapés,
RMI, personnes âgées, vaccination).
- éducation (collège, ramassage
scolaire).
- culture et patrimoine (bibliothèque,
CIO, IUFM, monuments publics).
- voirie (route départementale et une partie
des voies nationales depuis 2004).
- aménagement de l'espace et équipement
(intercommunalité, CCI, espaces naturels).
C'est le Conseil Général du
Puy-de-Dôme qui, avec l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne, accorde
les subventions pour les travaux d'alimentation en eau potable au
Syndicat de la Faye. Ces subventions sont accordées sous
certaines conditions et notamment à condition que le prix
de l'eau soit supérieur à 1,00 € HT calculé
sur une facture de 120 m3 (voir la
page prix
de l'eau). Le Syndicat de la Faye rempli cette condition.
Dépollution : action de réduire ou
supprimer la pollution de l'eau, de l'épurer.
Déshydratation : perte d'une partie de l'eau nécessaire
à un organisme vivant.
Désinfection : action de réduire les
germes microbiens de l'eau.
Désert : endroit où la végétation
est rare et où les précipitations n'atteignent pas
250 mm chaque année.
Détecteur de conduites métalliques :
méthode permettant de repérer les canalisations en
fonte ou en acier qui constituent les réseaux de distribution
d'eau potable. Un générateur créé un
champ magnétique autour de la conduite. En surface, on localise
ce champ magnétique à l'aide d'un récepteur.
Cette technique permet de faire un recolement de réseaux
(repérage) ou de détecter les conduites dans le cadre
d'investigation du sous-sol avant travaux de terrassement.
DETECTEUR DE CONDUITES
METALLIQUES

|
Détecteur de conduites non métalliques
: méthode permettant de repérer les canalisations
enterrées en PVC ou en polyéthylène (P.E.).
Deux solutions existent. La première consiste à créer
des vibrations acoustiques sur la conduite à l'aide d'un
générateur (marteau) et de rechercher à l'aide
d'un détecteur acoustique la zone où le bruit est
le plus élevé. La deuxième solution consiste
à introduire dans la conduite une sonde émettrice
en fibre munie de fils métalliques et permettant de créer
un champ magnétique et de détecter ce champs magnétique
en surface à laide d'un récepteur électromagnétique.
DETECTEUR DE CONDUITES
NON METALLIQUES
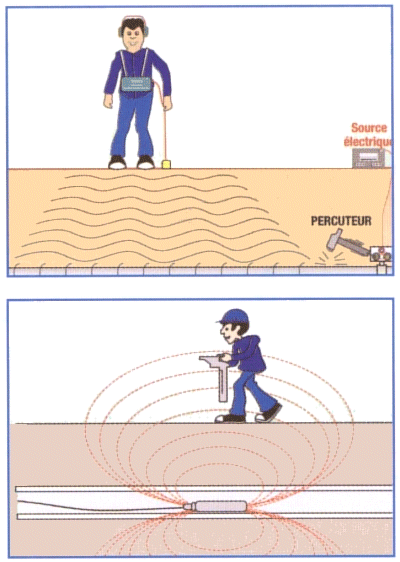
|
Détection acoustique des fuites : méthode
de recherche de fuites sur le réseau de distribution d'eau
potable consistant à écouter au niveau du sol le bruit
généré par la fuite à l'aide d'un amplificateur
mécanique ou électronique. L'auscultation au niveau
du sol se fait tous les mètres comme le montre le schéma
suivant :
DETECTEUR ACOUSTIQUE
DES FUITES
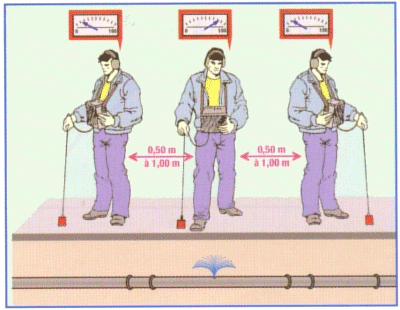
|
Détection de fuite par gaz traceur : méthode
de recherche de fuites sur le réseau de distribution d'eau
potable par injection d'un gaz traceur dans la conduite vide ou
en charge. Le gaz remonte à la surface au droit de la fuite.
Il est ensuite identifié grâce à une cellule
de détection permettant ainsi de localiser précisément
la fuite. Cette technique onéreuse est surtout employée
lorsque les techniques traditionnelles sont inefficaces et plus
particulièrement sur les réseaux ruraux en matière
plastiqueet dépourvus de point d'accès. Le gaz utilisé
(hélium ou hydrogène azotée) est inoffensif.
DETECTEUR DE FUITE
PAR GAZ TRACEUR
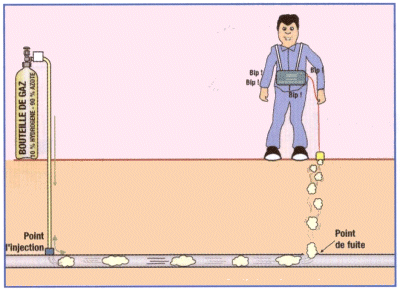
|
Dévaler : se dit d'un poisson quand il descend
un cours d'eau (dévalaison / avalaison).
Diaclase : émergence naturelle d'eau souterraine.
Dialogue compétitif : voir marché
public.
Diamètre nominal : diamètre intérieur
d'une conduite, noté DN.
Diatomées : type d'algues que l'on retrouve
dans les étendues d'eau contenant des nutriments en excès.
D.I.C.T. : voir Déclaration d'Intention
de Commencement de Travaux.
Digue : longue construction destinée à
contenir les eaux, tel un bassin naturel renforcé par une
digue afin de mieux retenir les eaux.
Dioxyde de chlore : appelé aussi bioxyde de chlore.
Il s'agit d'une technique de désinfection de l'eau potable
qui consiste à préparer sur le lieu même de
la désinfection le dioxyde de chlore à partir d'une
solution de chlorite de sodium et d'acide chlorhydrique. Un générateur
réalise le mélange puis une pompe doseuse injecte
le produit dans l'eau suivant le débit. Cette technique a
l'avantage de ne pas donner de mauvais goût à l'eau
contrairement au chlore,
d'avoir un très bon effet
rémanent et d'être moyennement onéreux.
En revanche, c'est un procédé qui ne peut être
réalisé que sur le site de désinfection car
le dioxyde de chlore est un produit sensible à la lumière
et à la température qui ne peut donc pas être
stocké ou transporté. Cette technique occasionne également
la formation de chlorites et de chlorates potentiellement toxiques.
Directive : une directive de l'Union Européenne
est un acte juridique qui s'adresse à un ou plusieurs Etats
membres. Elle représente une sorte de loi-cadre fixant des
objecctif sans prescrire à l'Etat membre par quels moyens
il doit les réaliser. Les Etats destinataires ont donc une
obligation quant au résultat mais sont laissés libres
quant aux moyens à mettre en oeuvre pour y parvenir.
Sa mise en oeuvre se réalise selon les
dispositions réglementaires de sa transposition en droit
national. La cour de justice européenne peut sanctionner
l'Etat qui ne respecteraient pas leurs obligations.
Directive cadre sur l'eau : directive 2000/60/CE du
parlement européen et du conseil du 23 octobre 2000 établissant
un cadre pour une politique communautaire de l'eau, communément
appelée directive cadre. Abréviation : D.C.E.. Elle fixe des
objectifs et des échéances, dont le "bon état" des eaux
en 2015, et établit une procédure pour les atteindre : réalisation
d'un état des lieux, définition d'un programme de surveillance,
consultation et participation du public à l'élaboration des plans
de gestion du bassin, adoption d'un programme de mesures, récupération
des coûts, etc.
Directive eaux brutes : directive 75/440/CEE du 16
juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles
destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres.
Cette directive concerne les exigences qui permettent de s'assurer
que l'eau douce superficielle utilisée ou destinée à être utilisée
à la production alimentaire rencontre certaines normes et est traitée
de façon appropriée avant d'être distribuée. Les eaux souterraines,
les eaux saumâtres ou les eaux destinées à la réalimentation des
nappes souterraines ne sont pas soumises à cette directive. Cette
directive a été transcrite en droit français par le décret du 19/12/1991,
qui transpose aussi d'autres directives (baignade, vie piscicole,
eaux conchylicoles,...).
D.I.R.E.N. : Direction Régionale de l'Environnement
dont deux services sont à connaître : le S.E.M.A.,
Service de l'Eau et des Milieux Aquatiques et le Service de la communication
et de la vie associative.
Disconnecteur : accessoire de robinetterie qui se
place après le compteur d'eau et qui a pour rôle la
protection contre les retours d'eau sur les réseaux présentant
un risque important (comme les hôpitaux par exemple). Il a
la même fonction qu'un clapet
anti-retour à la différence qu'il est équipé
d'une chambre de stockage de l'eau retournée qui peut être
vidangée automatiquement. Un disconnecteur présente
plus de sécurité qu'un simple clapet anti-retour.
Dispositions (au sens du S.D.A.G.E.) : mesures et
orientations sur lesquelles le S.D.A.G.E.
entend porter un effort particulier en vue d'un objectif déterminé
au niveau du bassin. Le contenu juridique de ces dispositions est
lié à la précision de formulation qui sera
adoptée. Une disposition clairement exprimée verra
ses effets juridiques renforcés car sa mise en oeuvre ne
pourra que peu prêter à interprétation.
Distillation : procédé qui consiste à
convertir en vapeur un liquide mêlé à un autre,
afin de les séparer.
Distribution : action de répartir l'eau vers les
consommateurs. Dans un réseau d'eau potable, il s'agit de
conduire l'eau d'un point de traitement (usine d'eau potable) ou
de stockage (réservoir
ou château d'eau)
vers le robinet du consommateur. Avant le point de traitement ou
de stockage, il s'agit de l'adduction
de l'eau.
La distribution d'eau potable se fait, à
partir des réservoirs ou des usines de potabilisation, par
des réseaux de canalisations équipés de divers
appareils de contrôle et d'entretien : vannes pour l'isolement
éventuel de tronçons, appareil de régulation
du débit ou de la pression, vidanges, ventouses, bouchons
et poteaux d'incendie, bouches de lavage et d'arrosage.
District hydrographique : zone terrestre et maritime
composée d'un ou de plusieurs bassins hydrographiques ainsi que
des eaux souterraines et côtières associées, identifiée selon la
D.C.E. comme principale unité pour la gestion de l'eau. Pour chaque
district doivent être établis un état des lieux, un programme de
surveillance, un plan de gestion (S.D.A.G.E. révisé) et un programme
de mesures.
D.M.A. : Dose Maximale Admissible. Limite permettant
d'établir les normes
de potabilité de l'eau destinée à la consommation
humaine. C'est la quantité d'une substance qu'un individu
peut absorber sans danger quotidiennement tout au long de sa vie.
DN : voir diamètre
nominal.
Domaine privé : par opposition au domaine
public, il est constitué de biens appartenant à
des personnes publiques (mairie ou toute autre collectivité
territoriale) mais ces biens ne sont pas des dépendances
du domaine public. Il ne sert pas au service public ni aux usagers.
Il s'agit par exemple des chemins ruraux qui sont des voies privées
contrairement aux autres routes mais ouverts à la circulation
publique. Les biens du domaine privé sont aliénables.
Domaine public : par opposition au domaine
privé, c'est l'ensemble des biens appartenant aux personnes
publiques (mairie ou toute autre collectivité
territoriale). Le domaine public est utilisé par les
usagers et les services publics. Les voies ferrées, les aérodromes,
les ouvrages militaires, les canalisations d'eau, de gaz et d'électricité
font partie du domaine public. Des charges pèsent sur le
domaine public. Ainsi, il existe une charge de voisinage que la
collectivité doit respester, il s'agit du droit de vue, du
droit d'égoût, de la libre desserte et du libre accès.
La collectivité a également à sa charge la
réduction de la pollution sonore due aux routes. A l'inverse,
il existe également une charge de voisinage au profit du
domaine public en obligeant les riverains à respecter certaines
règles. Le domaine public est réputé inaliénable.
Domaine public fluvial : historiquement, le domaine
public fluvial comprend les cours d'eau ou lacs navigables ou flottables
figurant à la nomenclature des voies navigables ou flottables établis
par décret en Conseil d'Etat. Abréviation : D.P.F.. Depuis
la loi de 1964, la nomenclature n'est plus liée à la navigabilité
et à la flottabilité du cours d'eau. Les cours d'eaux domaniaux
sont limités par la hauteur des eaux coulant à plein bord avant
de déborder. La délimitation du D.P.F. (cours d'eau, lac,...) peut
être faite par arrêté préfectoral.
Dossier de consultation des entreprises : document
réalisé par le maître d'oeuvre pour le compte
du maître d'ouvrage dans le cadre de la passation d'un marché
de travaux public. Ce dossier peut être également réalisé
par un service interne au maître d'ouvrage. Il permet autres
entreprises susceptibles de répondre à un appel d'offre
de connaître toutes les caractéristiques du marché
(volume des travaux, durée...).
Le dossier de consultation des entreprises
contient le règlement de la consultation, l'acte d'engagement,
le C.C.A.P. et le C.C.T.P.,
le contrat de maintenance éventuel, un questionnaire technique
et fonctionnel, un bordereau de prix, le D.Q.E.
et des plans.
Douce : se dit d'une eau faiblement minéralisée
par opposition à une eau dure. Voir aussi
dureté.
D.P.F. : voir Domaine Public Fuvial.
D.Q.E. : Devis Quantitatif et Estimatif. Document
apparaissant dans les procédures de marchés
publics.
D.R. : voir Demande
de Renseignements.
Drainer : action de faciliter l'écoulement
de l'eau dans un sol trop humide, au moyen d'une installation enterrée.
D.R.A.S.S. : Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales. Voir D.D.A.S.S..
D.R.I.R.E. : Direction Régionale de l'Industrie,
de la Recherche et de l'Environnement.
D.T.U. : Documents Techniques Unifiés. Document
apparaissant dans les procédures de marchés
publics. C'est un document normatif de portée générale
servant à préciser la coordination avec les autres
intervenants à la réalisation.
Duis ou duit : levée de pierres et de cailloux traversant
une rivière ou bordant une plage pour arrêter le poisson au jusant,
digue longitudinale ou biaise dans le lit de la Loire visant à régulariser
et canaliser un cours d'eau.
D.U.P. : voir déclaration d'utilité
publique.
Dure : se dit d'une eau fortement minéralisée
par opposition à une eau douce. Voir
aussi dureté.
Dureté : c'est un indicateur de la minéralisation
de l'eau qui prend en compte notamment les teneurs en calcium et
en magnésium de l'eau, mesurée par le titre
hydrotimétrique en degré français (°F).
Les eaux dures (eaux calcaires ou magnésiennes) laissent
déposer beaucoup de tartre et ont une dureté totale
supérieure à 30 °F. En revanche, les eaux douces
(eaux faiblement minéralisées) ont une dureté
totale inférieure à 20 °F. Une eau très
douce et dont le pH
est faible (acide) peut entraîner dans les réseaux
des phénomènes de corrosion (rouille), l'eau est alors
qualifiée d'agressive.
Une eau dure aura pour inconvénient un fort entartrage des
canalisations et des matériels (tels que chauffe-eaux, machine
à laver…). Pour mieux comprendre la notion de dureté
de l'eau, il faut savoir qu'une dureté ou un titre hydrotimétrique
de 1°F = 10 mg/l de CaCo3 = 0,1
mmol/l de CaCo3 (carbonate de calcium).
L'eau du Syndicat de la Faye est très douce et a un pH acide,
elle est donc agressive. |
| |
|
|
|