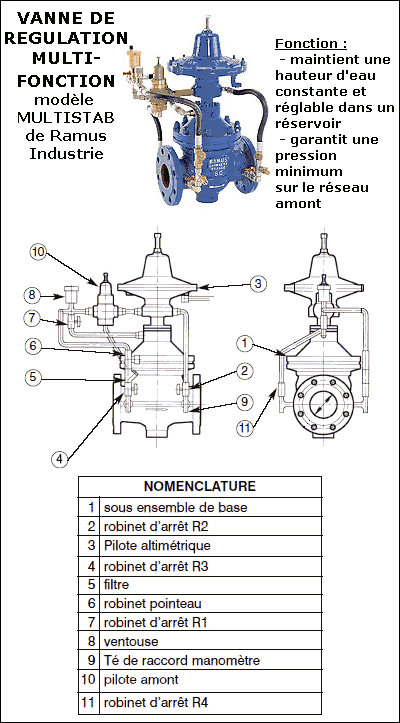Rabbatement de nappe :
abaissement en un point du niveau
pièzométrique sous l'effet d'un prélèvement
d'eau dans la nappe, de l'abaissement d'une ligne d'eau, d'un cours
d'eau en relation avec la nappe ou sous l'effet de travaux de terrassement.
Raccordement : court tronçon de tuyau, de canalisation,
servant à relier deux tuyaux, deux canalisations distinctes.
Radar géologique : méthode de détection
des conduites non métalliques enfouies dans le sol et constituant
le réseau de distribution d'eau potable. Cette technique,
issue de la prospection minière, consiste à émettre
dans le sol une onde électromagnétique qui est réfléchie
par l'interface des couches de terrain ou par la présence
de réseaux enterrés. Cette réflexion est captée
puis interpolée pour être visualisée sur un
écran de contrôle. Cette technique très onéreuse
n'est pas encore très au point pour la localisation de canalisations
enterrées.
Radiation : onde d'énergie (chaleur, lumière,
radio) envoyée à travers l'espace.
Radier : partie d'un cours d'eau sans profondeur sur laquelle
l'eau coule rapidement. C'est aussi le nom que l'on donne au fond
d'un ouvrage, captage ou réservoir.
Radiorelève : la radiorelève
est un système permettant de relever l'index des compteurs
d'eau, et notamment ceux des abonnés, à distance.
Ce procédé récent permet de relever les compteurs
d'eau même quand l'abonné est absent ce qui facilite
le travail de facturation (et ce qui évite les estimations).
La radiorelève s'effectue à l'aide d'un terminal portable
équipé d'une tête d'émission-réception
radio. Les compteurs sont quant à eux équipés
d'un module radio totalement étanche. La radiorelève
permet également de récupérer les données
collectées sur un ordinateur. On parle de télérelève
lorsque la relève ne se fait pas par une personne équipée
d'un terminal portable (relève ambulante) mais par radiofréquence
puis par un autre procédé de télécommunication
(téléphone RTC, GSM, internet...) jusqu'à l'ordinateur
de gestion des données.
 |
 Principe de la radiorelève
Principe de la radiorelève |
 |
| |

|
 Compteur d'eau équipé d'un module radio
Compteur d'eau équipé d'un module radio
pour la radiorelève |

|
Radon : le radon est un gaz qui provient de la désintégration
de l'uranium et du radium présents dans la couche terrestre.
Les sols granitiques libèrent plus de radon que les sols
sédimentaires. Ce gaz, dissout dans l'eau, peut faire l'objet
d'une recherche dans le cadre de la mesure de la radioactivité.
Très volatile, le radon s'échappe rapidement de l'eau
dès que celle-ci est à l'air libre. Le radon pénètre
dans l'organisme par l'air inhalé et plus rarement par l'eau
de boisson.
Rayon vert : ce rayon est observé très rarement.
Il s'agit d'une coloration verte lumineuse et de courte durée,
que l'on peut voir en mer ou au bord de la mer, au moment où
le soleil se couche à l'horizon.
Réactif : substance employée pour réagir
avec une ou plusieurs espèces chimiques en solution.
Réception des travaux : acte par lequel le maître
d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage construit par l'entrepreneur
sous les ordres du maître
d'oeuvre. La réception des travaux se décompose
en quatre étape :
- l'entrepreneur demande la réception au
maître d'ouvrage et au maître d'oeuvre en déclarant
la fin de ses travaux.
- le maître d'oeuvre vérifie les
ouvrages exécutés.
- le maître d'oeuvre donne des propositions
au maître d'ouvrage quant à l'état des ouvrages
commandés, il propose des réserves et une date de
fin des travaux.
- décision du maître d'ouvrage.
Rechloration : introduction d'un produit à effet
bactériostatique rémanent à l'invers e de la
désinfection.
Recommandation : en attirant l'attention sur un point particulier,
les recommandations ont pour objet de permettre une meilleure application
de politiques existantes ou bien encore la mise en oeuvre d'une
politique nouvelle soutenue par le S.D.A.G.E..
Récupération des coûts : principe
promu par la directive cadre sur l'eau et visant à ce que les utilisateurs
de l'eau supportent autant que possible, principalement au travers
du prix de l'eau, les coûts induits par leurs utilisations de l'eau
: investissements, coûts de fonctionnement et d'amortissement, coûts
environnementaux, etc. Ce principe est aussi appelé "recouvrement"
des coûts, même si la "récupération" des coûts est le terme officiel
de la directive. La directive cadre sur l'eau fixe deux objectifs
aux Etats membres en lien avec le principe de récupération des coûts :
- pour fin 2004, dans le cadre de l'état des lieux
: évaluer le niveau actuel de récupération, en distinguant au moins
les trois secteurs économiques : industrie, agriculture et
ménages,
- pour 2010, tenir compte de ce principe, notamment
par le biais de la tarification de l'eau. Si la directive a une
exigence de transparence du financement de la politique de l'eau,
en revanche, elle ne fixe pas d'obligation de récupération totale
des coûts sur les usages.
Recyclage : action de remettre l'eau usée dans
le cycle naturel après l'avoir dépolluée.
Redevance : somme d'argent due en contrepartie d'un
droit d'usage ou d'un service particulier comme le service de distribution
d'eau potable.
Reducteur de pression : voir régulateur
de pression.
Référence de qualité : en matière
de normes
à respecter pour l'eau potable, une référence
de qualité est une valeur indicative à satisfaire,
établie à des fins de suivi des installations de production
et de distribution d'eau et d'évaluation des risques pour
la santé des personnes, par opposition à une limite
de qualité. Les références de qualité
concernent 25 paramètres (coliformes totaux, dureté
de l'eau...).
Régie directe : lorsqu'une commune assure le
service de l'eau par ses moyens propres, elle opère en régie
directe, que l'on appelle couramment régie municipale.
Régie intéressée : voir délégation
de service.
Région : collectivité
territoriale au même titre que les communes, les régions
ont été créées en 1982. Une région
est dirigée par un conseil régional (instance délibérante)
composé de membres élus au suffrage universel. Ces
derniers élisent en leur sein le président du conseil
régional qui constitue avec ses vice-présidents une
commission permanente (instance exécutive). Le président
du conseil régional est élu pour 6 ans. Le conseil
régional a différentes mission dont :
- le développement régional.
- le choix des investissements à réaliser
par les collectivités.
- l'achat des équipement régionaux.
- l'attribution des aides fiancières pour
l'emploi.
- la subventions des entreprises régionales.
- l'action en terme d'infrastructures et de transport.
- la formation initiale, continue et professionnelle
avec notamment la gestion des lycées.
Les attributions de la région sont de différents
types, notamment budgétaires, relatives aux services publics,
économiques, culturelles, relatives à l'aménagement
du territoire et à la formation professionnelle. Les recettes
de la région proviennent de taxes locales et de dotations
de l'Etat dans le cadre de la décentralisation.
Le Syndicat de la Faye se situe dans la Région Auvergne mais
le Conseil Régional d'Auvergne n'apporte aucune aide financière
pour les travaux d'alimentation en eau potable.
Registre des zones protégées : registre
établi à l'échelle d'un bassin hydrographique identifiant les zones
désignées comme nécessitant une protection spéciale dans le cadre
de la législation communautaire en vigueur : zones vulnérables
(directive nitrates), zones sensibles (directive eaux résiduaires
urbaines), zones désignées au titre de la directive Natura 2000,
etc. L'échéance pour établir le registre des zones protégées est
décembre 2004. Ce registre doit ensuite être régulièrement mis à
jour.
Règlement d'eau : règlement qui régit les modalités
d'exploitation des barrages ou des installations hydrauliques en
général. A partir de 1995, approuvé par arrêté préfectoral, il est
établi à l'issue d'une enquête publique. Il mentionne les règles
de gestion des ouvrages (débit minimal, débit réservé, lachûre,...).
Pour les ouvrages de soutien d'étiage (en situation normale et en
situation de crise), il doit permettre de préciser comment la ressource
en eau sera partagée entre les prélèvements et le débit maintenu
dans les cours d'eau.
Régularisation des cours d'eau : action de
créer et/ou de gérer un ensemble d'aménagements sur le cours d'eau
ou le bassin versant visant à réduire les variations du régime hydrologique
d'un cours d'eau (étiage prononcé, crue torrentielle,...).
Régulateur : appareil comprant la mesure (signal
venant du capteur) à la consigne qui a été
programmée. C'est lui qui pilote le système, il donne
les ordres au variateur de fréquence dans le cas d'un surpresseur
à vitesse variable. Il agit toujours de façon à
ce que la mesure égale la consigne.
Régulateur de pression : voir pression.
Régulation : dans un réseau de distribution
d'eau potable, de nombreux paramètres permettent de contrôler
l'état de l'alimentation en eau, il s'agit à la fois
de la pression de l'eau,
du débit ou du
niveau de l'eau dans les réservoirs. La gestion de ces différents
facteurs forme la régulation de la distribution d'eau potable
dans un réseau. Pour réguler la pression de l'eau
dans un réseau, on utilise généralement un
régulateur de pression (pour plus de précision
voir au mot pression).
Pour réguler le niveau de l'eau dans un réservoir,
on emploie un robinet altimétrique (dont la description
se trouve à la page consacrée aux autres
ouvrages du Syndicat de la Faye). Enfin, on utilise un régulateur
de débit pour réguler le débit de l'eau dans
les canalisations. Ces trois fonctions peuvent être assurées
par un seul et même appareil appelé vanne de régulation
multifonction.
Suivant les options choisies, la vanne de régulation
multifonction peut faire office de :
- régulateur de pression
amont
- régulateur de pression
aval
- régulateur de pression
amont et de pression aval en même temps
- robinet altimétrique
- robinet altimétrique
et régulateur de pression amont en même temps
- régulateur de débit
- régulateur de débit
et régulateur de pression amont en même temps
- régulateur de débit
et robinet altimétrique en même temps
Le fonctionnement de cet appareil est simple, un ou plusieurs pilotes
de commande sont branchés directement sur la chambre d'alimentation
de la vanne. Ces pilotes régulent l'échappement de
la chambre ce qui a pour conséquence d'ouvrir ou de fermer
la vanne. Le type de régulation souhaité est obtenu
en changeant le pilote de commande. Le schéma suivant vous
montre le principe de fonctionnement d'une des nombreuses configurations
possibles de la vanne de régulation multifonction, ici le
robinet altimétrique couplé au régulateur de
pression amont :
|
|
Schéma de fonctionnement d'une vanne de régulation
multifonction (option robinet altimétrique
+ régulateur de pression amont)
Modèle : MULTISTAB (Ramus
Industrie)
|
|
Réhabilitation : consiste à réparer les
fonctions endommagées ou bloquées d'un écosystème, en ayant recours
à des solutions plus lourds, pour remettre l'écosystème sur sa
trajectoire dynamique et rétablir un bon niveau de résilience.
Relation rivière-nappe : échange d'eau dans
un sens ou dans l'autre entre une nappe et un cours d'eau. Suivant
le niveau de la ligne d'eau, et les saisons, la nappe alimente
le cours d'eau ou est alimentée par celui-ci notamment
lors des inondations. Dans le cas de karst,
ces relations sont importantes et localisées.
Rémanence : voir effet
rémanent.
Rémanent d'exploitation : partie des arbres exploités
qui reste au sol et n'est pas utilisée comme les branches,
l'écorce, les racines...
Remblai : par opposition à déblai,
masse de matériaux rapportés pour élever
un terrain, combler un creux ou ouvrage fait de matériaux
rapportés.
Renard : passage emprunté anormalement ou créé par l'eau
dans une digue, dans un barrage.
Rendement : paramètre représentant le rapport
entre la quantité d'eau réellement utilisée
par les consommateurs et celle introduite dans le réseau.
Le rendement permet d'apprécier la qualité d'un
réseau en terme de fuites et s'exprime en pourcentage.
On retient comme objectif un redement d'environ 80 % en zone rurale
et de 90 % en zone urbaine. Ce paramètre doit être
calculé par le distributeur d'eau tous les ans. Plus que
la valeur du rendement, c'est son évolution qui est à
prendre en compte. Ainsi, si la valeur a tendance à diminuer
au cours des années, cela signifie que le réseau
se dégrade. Ce paramètre est donc très important
pour la gestion du réseau mais il n'est pas suffisant pour
apprécier avec justesse l'état du réseau
car il est très influencé par les grosses consommations
comme en période de canicule par exemple, on calculera
aussi l'indice linéaire
de perte. Pour plus de précisions sur le rendement,
allez ici.
Rendement technique du réseau : voir rendement.
Rendzine : désigne un sol développé
sur une roche-mère calcaire, généralement
de faible épaisseur de 18 à 30 cm.
Reprofilage : opération exécutée
par les forestiers consistant à aplanir la surface du sol
en lui assurant une pente homogène, de façon à
permettre un bon écoulement superficiel des eaux.
Réseau d'assainissement : ensemble des ouvrages
construits par l’homme pour recueillir les eaux usées
à l'intérieur d'une agglomération. La majeure
partie de ces ouvrages sont des canalisations souterraines. Le
réseau d'assainissement est un des éléments
constituant du système d’assainissement qui est complété
par la station d'épuration des eaux usées. On parle
aussi de réseau d’égout.
Réseau de distribution : ensemble des ouvrages
de prélèvements (captage,
forage...), d'adduction
et de distribution d'eau aux divers utilisateurs.
Réseau de mesure : dispositif de collecte de données
correspondant à un ensemble de stations de mesure répondant à
au moins une finalité particulière. Chaque réseau respecte des
règles communes qui visent à garantir la cohérence des observations,
notamment pour la densité et la finalité des stations de mesure,
la sélection de paramètres obligatoires et le choix des protocoles
de mesure, la détermination d'une périodicité respectée. L'ensemble
de ces règles est fixé dans un protocole. Exemple : Réseau
National des Eaux Souterraines, Réseau National de Bassin.
Réseau maillé : c'est un réseau
d'alimentation en eau potable dont les canalisations forment une
boucle, appelée maille, autour d'une ville, d'un quartier
ou d'une rue ce qui permet, grâce à des vannes, d'isoler
une partie de ce réseau sans avoir à fermer l'eau
à toute la zone située à l'intérieur
de la maille ce qui est très pratique pour réparer
une fuite sur une conduite par exemple. Le réseau maillé
est l'inverse du réseau ramifié.
Excepté dans certains bourgs des communes
adhérentes, le réseau principal du Syndicat de la
Faye n'est pas un réseau maillé compte tenu de l'habitat
dispersé de son territoire. Un réseau maillé
permet une sécurité d'approvisionnement car l'eau
peut suivre plusieurs cheminements pour arriver à un même
point de livraison.
Réseau pluvial : ensemble des ouvrages construits
par l'homme pour recueillir les eaux de pluie à l'intérieur
d'une agglomération. Il peut être complété
par des réservoirs d'orage, des décanteurs, pour
éviter les pollutions déposées sur les sols
imperméabilisés.
Réseau ramifié : contrairement au réseau
maillé, le réseau ramifié est un réseau
de canalisations d'alimentation en eau potable sans boucle ou
maille autour de zone définie (bourg, quartier, rue...)
ce qui ne permet pas de réalimenter un secteur donné
lorsqu'une réparation s'effectue sur le réseau.
Le réseau principal du Syndicat de la Faye est un réseau
ramifié, nous sommes donc obligés de fermer l'eau
aux habitants lorsque nous réparons une conduite. Plus
les conduites sont éloignées du réservoir,
plus leur diamètre diminue. D'une conduite principale de
gros diamètre partent plusieurs conduites de petits diamètres,
c'est ce qu'on appelle un réseau ramifié ou arborescent.
Réserve utile : la réserve utile correspond
à l'eau présente dans le sol qui est utilisable
par la plante. Elle est exprimée en millimètres.
Réservoir : lieu de stockage de l'eau potable,
avant sa mise en distribution. Il peut être enterré
ou prendre la forme d'un château d'eau. Il assure trois
fonctions :
- il garantit une pression minimale dans le
réseau lorsqu'il est sous forme de château d'eau
(10 m de hauteur d'eau donne 1 bar de pression),
- il assure une sécurité d'approvisionnement
en cas d'incident sur le réseau (pollution accidentelle,
fuite, incendie...),
- il sert à stocker l'eau pendant les
périodes de faible consommation (la nuit le plus souvent)
pour pouvoir répondre à la demande de pointe sans
avoir à surdimensionner les installations de production,
on dit que le réservoir à un effet tampon sur la
consommation d'eau des usagers.
Les châteaux d'eau peuvent prendre différentes formes
: hyperbole, cuve conique, colonne, champignon ou à fort
encorbellement.
Réservoir hydropneumatique : associé à
une pompe, il forme un surpresseur et permet de fournir de l'eau
au réseau lorsque la pompe est arrêtée, d'amortir
les coups de bélier au démarrage et à l'arrêt
des pompes et d'éviter de maintenir une pompe en marche
quand la demande en eau est nulle. Il est aussi appelé
ballon. Les nouveaux ballons hydropneumatiques sont équipés
d'une membrane élastique (vessie) qui contient l'eau du
réseau. Suivant la pression du réseau, cette membrane
se remplie ou se vide.
Ressource : ensemble de potentialités qu'offre
le milieu physique, notamment dans les domaines énergétique,
minier, forestier etc.
Ressource disponible d'eau souterraine : taux moyen annuel
à long terme de la recharge totale de la masse d'eau souterraine
moins le taux annuel à long terme de l'écoulement requis pour
atteindre les objectifs de qualité écologique des eaux de surface
associées fixés à l'article 4, afin d'éviter toute diminution
significative de l'état écologique de ces eaux et d'éviter toute
dégradation significative des écosystèmes terrestres associés.
Restauration : consiste à favoriser le retour à l'état
antérieur d'un écosystème dégradé par abandon ou contrôle raisonné
de l'action anthropique. La restauration implique que l'écosystème
possède encore deux propriétés essentielles : être sur la
bonne trajectoire, avoir un bon niveau de résilience. Sans ces
conditions : réhabilitation.
Résurgence : se dit d'une source qui sort du sol
avec un débit de rivière, après avoir circulé
dans un réseau souterrain creusé naturellement.
Retour d'eau : il s'agit d'une inversion brutale du sens
d'écoulement qui provoque un retour d'une eau éventuellement
polluée depuis le poste utilisateur à l'aval vers
le réseau principal à l'amont. Ce phénomène
peut se produire en cas de siphonnage ou de contrepression.
Rigole : filet d'eau de ruissellement.
Ripisylve : boisement naturel qui longe les rives d'un
cours d'eau et qui jour un rôle essentiel dans le fonctionnement
de l'hydrosystème
fluvial, elle régule notamment le cycle du phosphore et
de l'azote.
Risque sanitaire : danger ou inconvénient (immédiat
ou à long terme) plus ou moins probable auquel la santé
publique est exposée. L'identification et l'analyse des
risques liée à un phénomène (inondation,
contamination...) permet généralement de prévoir
son impact sur la santé publique.
Rive droite - rive gauche : les rives droite et gauche
d'un cours d’eau se définissent par rapport au sens
du courant. Un cours d'eau possède ainsi une rive droite
et une rive gauche. Proches du cours d’eau, les rives peuvent
intégrer des zones humides : anciens bras de rivières,
marais…
Rivière : cours d’eau de faible ou moyenne
importance qui se jette dans un autre cours d’eau.
Robinet à flotteur : accessoire de robinetterie
équipant les réservoirs et permettant de contrôler
l'alimentation en eau de la réserve et limiter le niveau
de celui-ci à une valeur maximale. Voir une description
plus détaillée à la page réservoir.
Robinet altimétrique : équipement hydraulique
permettant de contrôler le niveau d'eau dans un réservoir
en ouvrant plus ou moins un piston. Vous trouverez plus de détails
concernant le robinet altimétrique en allant sur la page
des autres
ouvrages du Syndicat. Vous trouverez également sur
cette page une animation vous expliquant le fonctionnement du
robinet altimétrique.
Robinet-papillon : appareil de réglage de débit
et de sectionnement pour les gros diamètres de canalisations
(> 300 mm).
Robinet-vanne : voir vanne.
Rodenticide : produit qui empêche
le développement des rongeurs comme les ragondins, les
campagnols, les souris et les mulots ou les détruit. Les
rodenticides, comme les autres pesticides, peuvent se retrouver
dans l'eau. Ils sont toxiques et parfois cancérigènes.
Rosée :
vapeur d’eau qui se dépose, le matin ou le soir, en
gouttelettes très fines sur les végétaux
et d'autres corps à l'air libre.
Ruissellement :
partie des précipitations
qui parvient au cours d'eau ou se réunit aux eaux
de surfaces (mer, lac, étang...) lorsque l'intensité
de la pluie est plus forte que la capacité d'infiltration
du sol (sol saturé).
|