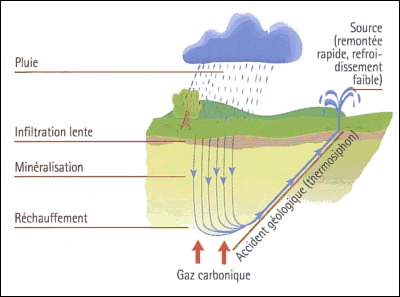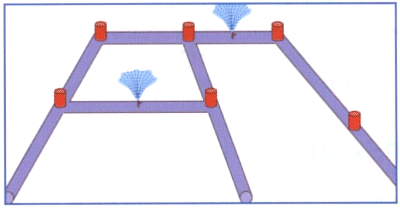|
| |
| En vous baladant sur ce site,
vous pouvez tomber sur un mot dont vous ne comprenez pas très
bien le sens. Heureusement, le Dic'eau est là pour vous aider!
Cliquez sur un des liens ci-dessous pour aller directement à
la lettre par laquelle commence le mot qui vous pose problème. |
| |
|
|
| |
|
|
| |
Eau :
liquide incolore transparent, inodore et insipide, sans saveur à
l'état pur. Chimiquement, l'eau est un corps composé
dont les molécules sont formées de deux atomes d'hydrogène
et d'un atome d'oxygène (H2O).
Eau brute : il s'agit de l'eau utilisée pour la production
d'eau potable, elle n'a donc encore subit aucun traitement. Elle
arrive dans les usines de potabilisation depuis des sources d'eau
superficielles (lac, étang, rivière...) ou souterraines.
Eau à l'état naturel, elle contient de nombreux éléments
minéraux et organiques, dissous ou en suspension. Elle n'est
pas chimiquement pure.
Eau de consommation : eau distribuée
par le réseau d'eau potable.
Eau de ruissellement : partie des précipitations
s'écoulant à la surface du sol.
Eau de source : une eau de source est mise en bouteille
sans traitement, ne garantissant donc que la qualité potable
et la provenance d'une source identifiée. C'est une eau issue
de nappes d'eaux souterrainnes dont la qualité chimique et
bactériologique est naturellement conforme aux normes de
potabilité.
Eau de surface : toutes les eaux qui s'écoulent ou
qui stagnent à la surface de l'écorce terrestre (lithosphére).
Il s'agit de l'eau des lacs et des rivières.
Eau de transition : définition de la directive cadre
sur l'eau, eaux de surface situées à proximité des embouchures de
rivières ou de fleuves, qui sont partiellement salines en raison
de leur proximité des eaux côtières mais qui restent fondamentalement
influencées par des courants d'eau douce.
Eau douce : eau peu chargée en sels dissous.
Eau dure : eau à forte teneur en calcium (sous forme
de calcaire ou carbonate de calcium) et magnésium par opposition
à l'eau douce (voir dureté).
Eau froide : dans la règlementation des compteurs
d'eau, une eau froide est comprise entre 0,1 et 30 °C.
Eau gazeuse : l'eau gazeuse est une eau qui pétille
car elle contient un gaz carbonique dissous.
Eaux grises : eaux générées
par les activités humaines domestiques sans eaux
vannes.
Eaux intérieures : définition de la directive
cadre sur l'eau, toutes les eaux stagnantes et courantes à la surface
du sol ainsi que toutes les eaux souterraines, et ceci en amont
de la ligne de base servant pour la délimitation des eaux territoriales.
Eau minérale : eau souterraine
chargée en éléments minéraux (plus d'1
mg/l) et en oligo-éléments.
De façon générale, les eaux des nappes
captives sont souvent plus minéralisées que les
eaux de nappes libres.
Certaines eaux minérales ont des propriétés
thérapeutiques. Leur composition chimique, contrôlée
par l'Académie de médecine, doit rester constante
et ne faire l'objet d'aucun traitement. Voir aussi eaux
thermales.
Eau naturelle : eau présente dans la
nature.
Eau pluviale : eau provenant de la collecte des eaux de
précipitations atmosphériques : pluies, neige, grêle...
Eau potable : c'est une eau qui peut être
consommée toute une vie sans risque sanitaire. Elle contient
un certain nombre de sels minéraux. Sa composition minéralogique
vient des différents terrains qu'elle a traversés.
Les caractéristiques d'une eau potable sont conformes aux
normes
de la santé publique.
Eau purifiée :
eau potable traitée comme l'eau du robinet mais servie en
bonbonne dans les collectivités.
Eaux résiduaires : voir eaux
usées.
Eau saumâtre : eau naturellement légèrement
salée du fait de sa proximité avec la mer ou de la
présence de sel dans le sol.
Eau souterraine : toutes les eaux se trouvant sous la surface
du sol en contact direct avec le sol ou le sous-sol et qui transitent
plus ou moins rapidement (jour, mois, année, siècle,
millénaire) dans les fissures et les pores en milieu saturé
ou non. La profondeur d'infiltration est de quelques dizaines de
mètres (eaux de sources "ordinaires") sauf pour
les eaux thermales, qui peuvent circuler
à plusieurs kilomètres de profondeur. Les eaux souterraines
constituent le deuxième stock mondial d'eau douce, après
les glaciers et calottes glacières, difficilement exploitables.
Voir aussi aquifère.
Les eaux souterraines ont pour origine la pluie.
L'eau des précipitations s'infiltrent dans le sol et descend
jusqu'à rencontrer une roche imperméable sur laquelle
elle s'accumule. Alors l'eau remplit tous les vides (pores et fissures)
et sature la roche du sous-sol pour former un réservoir d'eau
qu'on appelle nappe. La première nappe rencontrée
dans le sous-sol est dénommée nappe
phréatique. Ainsi, les eaux souterraines imbibent une
partie du sous-sol comme une éponge et constituent des réservoirs
appelés couches aquifères
ou nappes. Dans une nappe, l'eau circule très lentement.
Lorsqu'elles sont pleines, elles affleurent la surface du sol et
coulent sous forme de sources.
En France, près de 60 % de l'eau destinée
à la consommation humaine provient d'eaux souterraines.
Eau thermale : eau de sources chaudes. Chaud signifie
ici sortant à une température supérieure à
la température moyenne annuelle du lieu d'émergence,
corrigée de + ou - 1°C en fonction de la saison. Cette
eau se réchauffe en s'infiltrant profondément sous
terre (la température augmente avec la profondeur d'environ
3°C par 100m). Se réchauffant, elle perd en densité
et, si son chemin croise une faille importante, elle l'emprunte
et remonte rapidement à la surface sans perdre beaucoup de
température.
Une eau thermale est une eau
minérale car elle dissoud partiellement les roches où
elle circulent et se charge ainsi en divers éléments
minéraux.
Dans l'Auvergne volcanique, les eaux thermales
possèdent une nature carbo-gazeuse (elles sont mélangées
avec du gaz carbonique dégagé par le manteau terrestre)
qui est caractéristique du type de volcanisme du Massif Central.
|
|
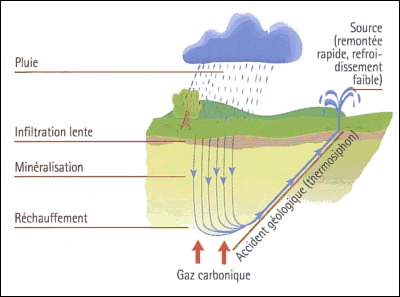 Fonctionnement schématique des sources thermales
Fonctionnement schématique des sources thermales |
|
Eaux usées : les eaux usées,
rendues impropres à la consommation, proviennent des équipements
domestiques (éviers, lavabos, toilettes, lave-linge, lave-vaisselle)
ou des industries. Elles se rejettent dans un regard de branchement
placé en limite de chaque maison pour être collectées
et acheminées des égouts vers une station de dépollution
ou d'épuration.
Eau utile : stock d'eau mobilisable et exploitable.
Eaux vannes : eaux des W.C..
Ebullition : phénomène physique accompagnant
le passage à l'état gazeux d'un liquide porté
à une température déterminée et dans
lequel se forment des bulles de vapeur qui viennent crever à
la surface.
Echelle limnimétrique : règle graduée permettant
d'apprécier directement la cote du niveau de l'eau dans un réservoir,
un cours d'eau, etc.
Eclusée : volume d'eau lâchée à partir d'un ouvrage
hydraulique (ouverture d'une porte d'écluse, turbinage d'eau stockée
dans un barrage réservoir,...) et se traduisant par des variations
de débits brusques et artificiels.
Ecologie : l'écologie est l'étude scientifique
du milieu dans lequel vivent les êtres vivants ainsi que les
relations de ces êtres vivants avec leur environnement naturel.
Protéger l'eau, protéger la ressource, c'est être
à l'écoute de notre environnement, du milieu naturel
dans lequel nous évoluons.
Ecosystème : association d'un environnement
physico-chimique spécifique avec une communauté vivante,
les deux étant en perpétuelle interaction.C'est aussi
l'ensemble des êtres vivants (la biocénose), des éléments non vivants
et des conditions climatiques et géologiques (le biotope) qui sont
liés et interagissent entre eux et qui constitue une unité fonctionnelle
de base en écologie.
Ecosystèmes associés : ensemble en relation
permanente ou temporaire avec le milieu courant par des connections
soit superficielles soit souterraines : îles, bras morts,
prairies inondables, forêts inondables, ripisylves, sources
et rivières phréatiques.
Ecotone : zone de transition entre deux écosystèmes.
Ecoulement : mouvement de l'eau qui se répand ou
s'écoule. Les pluies
efficaces sont à l'origine des écoulements superficiel
et souterrain. L'écoulement superficiel est collecté
directement par le réseau hydrographique. Il se produit dans
les heures ou jours qui suivent la pluies. Par comparaison avec
l'écoulement superficiel, l'écoulement souterrain
peut être lent, différé et de longue durée
(quelques heures à plusieurs milliers d'années).
Effet cumulatif : certains éléments que l'on
peut retrouver dans l'eau, comme l'arsenic, le plomb ou le mercure,
ont sur l'organisme un effet dit cumulatif c'est à dire qu'ils
s'accumulent en certains endroits du corps et deviennent toxiques
à long terme. Il n'y a ni plomb ni arsenic ni mercure dans
l'eau distribuée par le Syndicat de la Faye.
Effet rémanent : c'est la persistance de la
désinfection dans le réseau de ditribution d'eau potable
après le lieu même d'application du désinfectant.
Autrement dit, si la désinfection a lieu dans un réservoir,
le désinfectant garde son effet même dans les canalisations
situées après le réservoir. Le chlore
et le dioxyde de chlore sont utilisés en désinfection
de l'eau potable car ils ont un très bon effet rémanent,
et c'est aussi pour cela que l'eau a un goût de chlore aux
robinets des consommateurs. En revanche, l'ozone et les ultraviolets,
deux autres types de désinfection, ont un très mauvais
effet rémanent. L'effet rémanent permet de préserver
la qualité de l'eau pendant son transport.
Effluent : les effluents sont les eaux usées
contenant des matières polluantes, rejetées par les
habitations et les industries.
E.H. : voir équivalent-habitant.
Encéphalopathie : terme générique
recouvrant les affections diffuses généralement d'origine
toxique touchant le cerveau. Elles se manifestent par la confusion
mentale, le coma ou des crises d'épilepsie. Elle peut être
causée par de trop fortes concentrations d'aluminium dans
l'eau potable.
Endotoxine : voir toxine.
Energie hydraulique : energie produite par le mouvement
naturel de l'eau dans un cours d'eau, récupérable
soit directement pour faire tourner un moulin à eau ou aujourd'hui
un moteur, soit indirectement après transformation en énergie
électrique. Contrairement au pétrole par exemple,
l'énergie hydraulique est renouvelable et propre.
Engrais : substance organique ou minérale destinée
à la fertilisation du sol.
Enregistreur de bruit : appareil permettant la détection
d'un niveau acoustique minimum permanent assimilable à la
présence d'une fuite. Utilisé généralement
au nombre de 6 à la fois, les enregistreurs de bruit sont
installés sur les têtes de vannes dans les bouches
à clé du réseau de distribution d'eau potable
durant la nuit. Ils sont ensuite relevés à l'aide
d'une unité mobile ou d'un PC. Lorsque le niveau sonore est
plus élevé au niveau de deux enregistreurs placés
l'un à la suite de l'autre, la canalisation entre ces deux
enregistreurs est susceptible de présenter une fuite. C'est
ce que l'on appelle, la prélocalisation des fuites.
ENREGISTREUR DE BRUIT
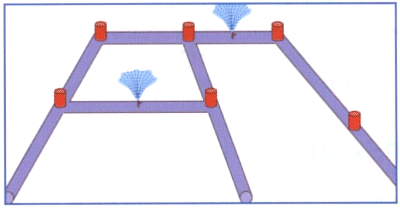
|
Enregistreur de données : appareil permettant
d'enregistrer différents types de données (volume,
débit, pression) sur les réseaux de distribution d'eau
potable sur une courte période (jour, semaine, mois) dans
le cadre d'un diagnostic du réseau. L'installation de cet
appareil, aussi appelé logger, se fait sur les compteurs
équipés d'une tête émettrice, sur un
débitmètre ou sur une prise en charge pour l'acquisition
des pressions. Les données sont ensuite transférée
sur ordinateur pour leur traitement. On utilise cet appareil notamment
pour mesurer le débit de fuite la nuit entre 1h et 4h du
matin.
ENREGISTREUR DE DONNEES

|
Entartrante / entartrage : se dit d'une eau fortement
minéralisée et dont la conductivité
est supérieure à 180 µS/cm. Par opposition à
une eau agressive, une
eau est entartrante lorsqu'elle dépose une couche de calcaire,
appélée tartre, sur les parois d'un récipient
ou à l'intérieur d'une canalisation. Le tartre est
le caronate de calcium (CaCO3)
qui précipite sur les surfaces d'écoulement, il se
cristallise sur les parois. En général, l'eau potable
distribuée est très légèrement entartrante
pour permettre la formation d'un film protecteur sur les parois
internes des canalisations (couche de Tillmans). L'eau du Syndicat
de la Faye n'est pas entartrante.
Entérobactérie : bactérie du
tube digestif de l'homme et de l'animal.
Entrepreneur : il construit, sous les ordres du maître
d'oeuvre, les ouvrages commandés par le maître
d'ouvrage.
Entretien des cours d'eau : ensemble d'actions régulières
visant à conserver les potentialités de l'écosystème (biotope, habitat
et reproduction des espèces, écoulement des eaux, stabilisation
des rives, filtration des eaux), à satisfaire les usages locaux
(navigation, loisirs, pêche, paysages,...) et à protéger les infrastructures
et les zones urbanisées.
Environnement : c'est l'ensemble des conditions naturelles,
physiques, chimiques, biologiques, culturelles et sociologiques,
susceptibles d'agir sur les organismes vivants et les activités
humaines. Par sa définition même, ce secteur d'activité
est difficile à cerner. De fait, l'environnement embrasse
des champs de compétences variés.
Enzyme : protéine ou ensemble de protéines
qui active une réaction biochimique spécifique.
EPA : Etablissement Public Administratif, il s'agit
d'EPCI particuliers comme l'ANPE (Agence Nationale
Pour l'Emploi) ou la Caisse de dépôts et consignations.
Ils sont donc indépendants de l'Etat.
EPCI : Etablissement Public de Coopération
Intercommunale, ce sont des collectivités
territoriales, comme les communes ou les régions par
exemple, qui regroupent plusieurs communes. Les communautés
de communes et les syndicats intercommunaux sont des EPCI. Ainsi,
le Syndicat de la Faye est un établissement public de coopération
intercommunale. Les EPCI sont créés après avis
de la Commission Départementale de Coopération Intercoomunale
(CDCI) qui est composée du préfet du département
et d'élus locaux (maires).
Ainsi, c'est un arrêté préfectoral qui créa
le Syndicat de la Faye le 9 août 1962 (voir la page historique).
Comme toutes les collectivités territoriales, les EPCI sont
composés d'une instance délibératrice (le comité
syndical ou le conseil communautaire) et d'une instance exécutive
(le président élu parmi le comité ou le sonseil).
Une instance consultative peut être également créée
pour les EPCI de plus de 50 000 habitants.
Epi : ouvrage établi suivant un certain angle dans
un cours d'eau pour fixer la forme de son lit.
EPIC : Etablissement Public Industriel et Commercial,
il s'agit d'EPCI dont le capital et la direction
sont publics mais dont la gestion est privée comme EDF (Electricité
De France), GDF (Gaz De France), l'ONF (Office National des Fôrets)
ou la SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer).
Epidémie : atteinte simultanée d'un
grand nombre de personnes ou d’êtres vivants d'un pays
ou d'une région par une maladie contagieuse comme la grippe,
le choléra, la fièvre typhoïde, la fièvre
aphteuse, la peste porcine, la vache folle…
Epuration : opération consistant à nettoyer
les eaux usées avant de les restituer au milieu naturel.
Selon la taille de l'équipement, on parle de station d'épuration
ou d'usine d'épuration.
Equivalent-habitant : unité de mesure notée
E.H. qui représente le volume des eaux usées produit
en moyenne par une personne sur une journée, c'est à
dire environ 180 litres.
Erosion : ensemble de phénomènes constitués
par la dégradation du relief, le transport et l'accumulation
des matériaux arrachés. L'érosion est un processus
naturel sur toutes les terres, dû principalement à
l'action de l'eau, du vent et aggravé par les pratiques de
préparation du sol.
Escherichia coli : bactérie colibacille
du groupe des coliformes
fécaux. Systématiquement recherché dans l'eau
potable, ce germe est un très bon témoin de contamination
par des matières fécales.
Estuaire : espace de rencontre entre les eaux continentales
(eaux douces) et les eaux marines (eaux salées). Un estuaire
correspond à l'entrée d’eau de mer dans une rivière,
aussi loin que la marée pénètre dans ce cours
d’eau.
Etanchéité : un textile ou une membrane
est étanche par exemple, lors qu'il est imperméable
à l'eau.
Etang : plan d'eau peu profond et peu étendu,
généralement creusé par l'homme.
Etat chimique : l'état chimique est l'appréciation
de la qualité d'une eau sur la base des concentrations en polluants.
L'état chimique comporte deux classes : bon et mauvais.
Etat de l'eau : toute matière peut passer par
différents états : solide, liquide, gazeux. Malgré
des propriétés souvent originales, l'eau ne fait pas
exception à cette règle. A 100 °C, sous une pression
atmosphérique normale, elle entre en ébullition et
se transforme en vapeur. Elle est alors dans son état le
plus simple, qui est aussi le plus désordonné. Les
molécules s'ignorent les unes les autres, les contraintes
de cohésion sont supprimées.
En dessous de 100 °C, elle cesse de bouillir
et demeure, comme on la connaît et comme on l'aime, à
l'état liquide. A quantité égale, son volume
sera alors 1 700 fois plus petit que celui qu'elle occupait quand
elle était vapeur.
En outre, elle est devenue à peu près
incompressible : le passage de 1 à 2 atmosphères ne
réduit plus son volume que de 0,01 %. La raison en est que
les molécules d'eau sont maintenues trés rapprochées.
Néanmoins, une certaine liberté de mouvement leur
est encore accordée, qui permet la fluidité, caractéristique
de cet état.
A l'état solide, autrement dit prise en
glace, l'eau cristallise et les molécules s'ordonnent selon
une disposition géométrique régulière.
La température n'est pas la seule en cause
dans les changements d'état. La pression y prend une part
déterminante. En haut de l'Everest, l'eau bout à 87
°C. Et si la pression baisse encore jusqu'à atteindre
une valeur 165 fois inférieure à 1 atmosphère,
on peut observer, à condition de maintenir la température
à 0,01 °C, l'image paradoxale d'un glaçon flottant
dans de l'eau bouillante, sans fondre!
Etat quantitatif : l'état quantitatif d'une masse
d'eau souterraine est l'appréciation de l'équilibre entre d'une
part les prélèvements et les besoins liés à l'alimentation des eaux
de surface, et d'autre part la recharge naturelle. L'état quantitatif
comporte deux classes : bon et médiocre.
Etat solide : L'eau devient solide à 0°C
et apparaît sous forme de glace, de neige…
Etiage : débit minimum d'un cours d'eau calculé
sur un pas de temps donné en période de basses eaux.
Ainsi pour une année donnée on parlera de :
- débit d'étiage
journalier,
- débit d'étiage
de n jours consécutifs,
- débit d'étiage
mensuel : moyenne des débits journaliers du mois d'étiage.
Pour plusieurs années d'observation, le
traitement statistique de série de débits d'étiage
permet d'obtenir un débit d'étiage fréquentiel.
La série doit avoir si possible au moins 30 observations.
A titre indicatif, le débit d'étiage
mensuel quinquennal est le débit de récurrence 5.
La récurrence signifie qu'après calcul sur une série
d'observations, on a constaté que ce débit n'est pas
dépassé une année sur cinq en moyenne. Ce débit
d'étiage mensuel quinquennal constitue le débit d'étiage
de référence pour la mise en oeuvre du décret
nomenclature.
En distribution d'eau potable, le débit
d'étiage est mesuré pour les sources captées
à la fin de l'été, en septembre ou en octobre.
Eutrophisation : du grec "eu" : bon, et
"trophos" : nourri, phénomène de pollution
des eaux dû soit à une augmentation incontrôlée
de la quantité de résidus d'engrais (nitrates ou phosphates
en particulier) soit à des rejets d'eau chaude (centrales
électriques par exemple) et qui a pour conséquence
la prolifération de nombreux êtres vivants (algues
en particulier) dans les cours d'eau et les plans d'eau. Au-delà
de certaines limites, l'équilibre entre les espèces,
végétales ou animales, peut être rompu au profit
de certaines d'entre elles. Par exemple, la décomposition
des végétaux provoque une diminution notable de la
teneur en oxygène ce qui provoque une diversité animale
et végétale amoindrie et des usages perturbés
comme l'alimentation en eau potable.
Ce phénomène n'a pas lieu dans l'eau
distribuée par le Syndicat de la Faye puisque l'eau a une
origine exclusivement souterraine.
Etude d'impact : étude dont les modalités,
la nécessité et les dénominations suivant l'importance du projet
(étude d'impact, notice d'impact) sont fixées par des règles définies
dans les décrets. Elle consiste à identifier les facteurs liés à
un projet d'aménagement pouvant avoir des effets plus ou moins importants
sur l'environnement permettant ainsi d'en apprécier les conséquences
et de définir des mesures correctives. Elle comprend au minimum :
- une analyse de l'état initiale du site et de
son environnement.
- une analyse des effets directs et indirects temporaires
ou permanents du projet : sur l'environnement et ses différents
éléments (faune, flore, sites, paysages, sols, eaux, air, climat,
milieux naturels et équilibres biologiques,...), sur la protection
des biens et du patrimoine culturel, le cas échéant sur la communauté
du voisinage ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique.
- les raisons pour lesquelles le projet a été
retenu.
- les mesures envisagées pour supprimer, réduire
et si possible compenser les conséquences dommageables du projet
sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.
- une analyse des méthodes utilisées pour évaluer
les effets du projet sur l'environnement. Elle constitue un des
éléments nécessaires au dossier de demande d'autorisation d'implanta-tion
et d'exploitation des installations projetées et doit notamment
figurer dans le dossier d'enquête d'utilité publique s'il y a lieu.
Cette étude doit faire l'objet d'un résumé non technique.
Evaporation : transformation de l'eau en vapeur sous
l'effet de la chaleur dégagée par le soleil.
Evapotranspiration : émission de vapeur d'eau
résultant à la fois de l'évaporation, phénomène
purement physique, et de la transpiration des végétaux
sous l'effet du rayonnement solaire. Elle s'exprime en millimètres.
La recharge des nappes phréatiques par les précipitations
tombant en période d'activité du couvert végétal
peut être limitée. En effet, la majorité de
l'eau est évapotranspirée par la végétation.
Exotoxine : voir toxine.
Expression en ppm (partie par million) : dérivée
de l'expression du pourcentage
de chlore actif, elle exprime la masse de chlore gazeux exprimée
cette fois en milligrammes ramené à 1 kg de produit.
Exemple : une solution à 0,2 % de chlore actif est une solution
à 2 000 ppm de chlore gazeux libérable.
Exutoire : désigne l'ouverture par laquelle
un cours d'eau se jette dans un autre cours d'eau dont il est l'affluent. |
| |
|
|
|