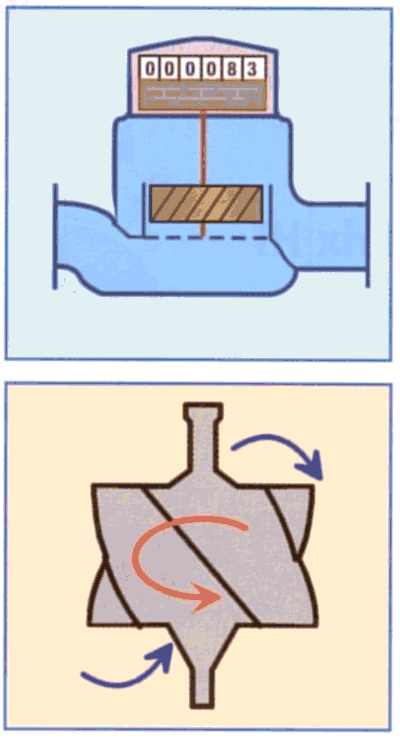|
Cahier des clauses administratives générales
: le C.C.A.G. est un document demandé par les entreprises
quand ces dernières souhaitent répondre à
un appel d'offre. La
collectivité qui ouvre un marché
public doit donc fournir ces renseignements. Le C.C.A.G. est
un acte d'engagement du contrat qui récapitule les obligations
réciproques du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur.
C'est l'ensemble des règles administratives et financières.
Les C.C.A.G. peuvent être de quatre ordres : fournitures
courantes et services, travaux, prestations intellectuelles et
marchés industriels.
Cahier des clauses administratives particulières
: le C.C.A.P. est un document demandé par les entreprises
quand ces dernières souhaitent répondre à
un appel d'offre. La
collectivité qui ouvre un marché
public doit donc fournir ces renseignements. Le C.C.A.P. fait
partie du Dossier de Consultation
des Entreprises réalisé par le maître
d'oeuvre. C'est un document pré-rempli qui existe sous
forme de modèles modifiables. Il est rédigé
pour chaque opération qui constitue le marché public,
il complète ou déroge au C.C.A.G..
Cahier des clauses techniques générales :
le C.C.T.G. est un document demandé par les entreprises
quand ces dernières souhaitent répondre à
un appel d'offre. La
collectivité qui ouvre un marché
public doit donc fournir ces renseignements. Comme pour le
C.C.A.G., le C.C.T.G. récapitule les
obligations techniques et réciproques du maître d'ouvrage
et de l'entrepreneur.
Cahier des clauses techniques particulières :
le C.C.T.P. est un document demandé par les entreprises
quand ces dernières souhaitent répondre à
un appel d'offre. La
collectivité qui ouvre un marché
public doit donc fournir ces renseignements. Le C.C.T.P. est
un document spécifiant la qualité des ouvrages et
leur localisation, les matériaux utilisés et les
différentes cotations. Il stipule les dérogations
éventuelles au C.C.T.G..
Calcaire : roche blanche soluble et friable. Une
eau est dite calcaire, ou dure, lorsqu'elle renferme du carbonate
de calcium et du magnésium. Elle est facilement repérable
car elle laisse des traces blanchâtres sur la vaisselle.
Calcium : métal blanc et mou qui est très
abondant dans la nature et qui constitue 99% du tissu osseux.
Il est à l'origine des eaux dites pétrifiantes,
qui sont à la base des stalagmites et stalactites.
Canal : cours d’eau artificiel, construit par l’homme
pour l’irrigation, l’énergie, le refroidissement,
le transport ou l’alimentation en eau potable. Il est alimenté
par prélèvement d’eau des cours d’eau
ou des retenues.
Canalisation : conduite ou tuyau destiné à
transporter l'eau potable.
Caniveau : canal d’évacuation des eaux,
placé de chaque côté d’une chaussée.
Capillaire : qui est fin comme un cheveu, qui est
de très petite section.
Capillarité : la capillarité représente
le phénomène physique de tension à la surface
de l'eau qui lui permet de monter dans de fins tubes appelés
tubes capillaires.
Captage : ouvrage ou action de prélever de
l'eau. Un captage est réalisé soit au niveau des
rivières et des sources (comme c'est le cas au Syndicat
de la Faye), soit dans les nappes par pompage.
Capteur de pression : appareil mesurant la pression
et délivrant un signal électrique proportionnel
à cette pression.
Carbonate de calcium : CaCO3,
c'est le tartre. Voir tartre.
Cascade : une cascade naturelle est une succession
étagée de chutes d'eau. Artificiellement, des cascades
sont recréées en station de production d'eau potable
pour aérer l'eau après captage.
Cation : voir ion.
Cavitation : c'est un phénomène qui
se produit lorsqu'un organe d'obturation, comme une vanne, est
maintenu proche de la fermeture. La pression dans la veine fluide
est réduite et l'énergie de pression est alors localement
transformée en énergie de vitesse (théorème
de Bernouilli). Si cette pression devient inférieure à
la pression de vaporisation du liquide, le phénomène
de cavitation prend naissance et provoque du bruit, des vibrations
et des détériorations sur les parois avoisinantes
de la conduite. C'est pour cette raison qu'un robinet-vanne à
opercule doit obligatoirement être totalement ouvert ou
fermé.
C.C.A.G. : voir Cahier des Clauses Administratives
Générales.
C.C.A.P. : voir Cahier des Clauses Administratives
Particulières.
C.C.T.G. : voir Cahier des Clauses Techniques Générales.
C.C.T.P. : voir Cahier des Clauses Techniques Particulières.
Certification : une certification est une assurance
de conformité de l'eau potable à des caractéristiques
sanitaires ou à des règles d'hygiène préétablies.
Champs captants : zone englobant un ensemble d'ouvrages
de captages prélevant l'eau souterraine d'une même
nappe par pompage.
Charbon actif : charbon végétal qui
élimine les pesticides, les matières organiques
et absorbe les goûts et les odeurs de l'eau lors de son
traitement.
Château d'eau : réservoir placé
sur un point haut, pour assurer la distribution de l'eau sous
pression. Le Syndicat de la Faye n'utilise pas de châteaux
d'eau mais des réservoirs semi-enterrés car la région
où se situe son territoire est semi-montagneuse ce qui
permet d'avoir de la pression naturellement grâce aux pentes
du paysage.
Chaussée : partie d'une route aménagée
pour la circulation des piétons et des véhicules.
Elle est constituée de différentes couches qui sont
:
- la couche de roulement, c'est la couche
superficielle de la chaussée sur laquelle roule les véhicules,
elle doit assurer l'écoulement des eaux de ruissellement,
offrir une bonne adhérence et une bonne résistance
et ne pas provoquer de nuisances sonores. Elle peut être
en pavés (pour les piétons), en enrobé, en
enduit, en asphalte ou en béton coulé. La couche
de roulement est aussi appelée couche de revêtement.
- la couche de liaison se situe sous
la couche de roulement, ces deux couches forment la couche de
surface. La couche de liaison est une couche anti-orniérage,
elle doit avoir les mêmes caractéristiques que la
couche de roulement. Elle est faite en béton bitumeux ou
en béton de gravillons.
- la couche de base se situe sous la
couche de liaison. C'est la couche qui est soumise directement
aux efforts, elle permet le réglage de la pente. Elle est
faite de grave naturelle
ou traitée ou concassée.
- la couche de fondation est située
sous la couche de base, elles forment toutes les deux la couche
d'assise. La couche de fondation doit résister aux efforts
verticaux et assurer un bon report des charges sur les couches
inférieures. Elle est composée de grave naturelle
ou traitée. Elle mesure de 20 à 60 cm en fonction
de la qualité du sol support, de l'intensité du
trafic et des températures.
- la couche de forme se situe entre la
couche de fondation et le sol support, elle assure l'homogénéisation
du fond de fouille. La couche de forme permet de mieux répartir
les charges sur le terrain. Elle est composée de matériaux
prix sur le site des travaux ou de grave naturelle.
- le sol support constitue, dans le cadre
de chantiers d'enfousissement de canalisation d'eau potable, le
fond de fouille. Si le sol support est de mauvaise qualité,
une couche anticontaminante à base de géotextile
peut lui être ajoutée pour éviter par exemple
des remontée d'eau sous la chaussée.
On distingue différents types de chaussées :
- les chaussées souples qui reprennent
leur aspect après déformation, elles sont composées
de matériaux traités avec des liants hydrocarbonés
(bitume). Ce sont des chaussées épaisses.
- les chaussées rigides réalisées
à partir de granulats et de ciment.
- les chaussées semi-rigides à
la composition mixte. Leur couche de surface est traitée
aux liants hydrocarbonés et leur couche d'assise est faite
avec des liants hydrauliques (ciment).
Chloramine : résidu d'une désinfection
au chlore résultant d'une combinaison entre le chlore libre
et certaines matières organiques à base d'ammonium.
Cette substance est cancérigène. Voir chlore.
Chloration : le chlore protège
l'eau pendant son transport dans les canalisations. Son effet
désinfectant est rémanent, c'est-à-dire qu'il
perdure dans le temps.
Chlore : le chlore est l'un des meilleurs désinfectants
utilisés en eau potable. Le chlore et les produits chlorés,
l'hypochlorite de sodium (ou eau de Javel) et l'hypochlorite de
calcium, se dissocient immédiatement dans l'eau pour former
:
- l'acide hypochloreux,
- l'ion hypochlorite.
C'est essentiellement l'acide hypochloreux qui
est le composé le plus actif dans les mécanismes
de désinfection (effet bactéricide notamment), c'est
pourquoi il est aussi appelé le chlore actif. La
proportion des deux composés dépend essentiellement
de la valeur du pH
de l'eau et de sa température. Ainsi, un pH
acide favorise la présence de l'acide hypochloreux et donc
une meilleure désinfection de l'eau. Une température
faible favorise également la formation de l'acide hypochloreux.
Pour un effet rapide du chlore et une économie
en produits, il convient de traiter l'eau à des valeurs
de pH proches de la
neutralité (pH = 7). Ainsi, on procèdera à
la désinfection avant tout traitement de neutralisation
et/ou de reminéralisation élevant le pH,
sauf dans le cas où la chloration n'est utilisée
que pour ses capacités de rémanence dans le réseau.
Après action du chlore sur les matières
organiques, azotées et autres composés oxydables,
il subsiste un résiduel de chlore se présentant
sous différentes formes : les chloramines et les organochlorés.
Ce sont des composés qui se forment entre le chlore libre
et certaines matières organiques ou hydrocarbures (dans
ce cas ils sont appelés trihalométhanes), ces substances
sont cancérigènes. La dissociation du chlore libre
dans l'eau peut se résumer ainsi :
CHLORE TOTAL (Cl2)
=
CHLORE LIBRE + CHLORE COMBINE (chloramines et organochlorés)
CHLORE LIBRE
=
CHLORE ACTIF (acide hypochloreux HClO) + CHLORE POTENTIEL (ion
hypochlorite ClO-)
Pour une bonne surveillance en continu de la désinfection,
il convient de mesurer le chlore actif, soit directement à
l'aide d'une sonde ampérométrique à membrane
sélective, soit en mesurant le chlore libre et le pH
pour en déduire par calcul le chlore actif, en sachant que
la mesure du chlore libre est celle la plus fréquemment employée.
Chlore actif : acide hypochloreux. Voir chlore.
Cirrus : nuage d'aspect fibreux et constitué de cristaux
de glace.
Cité lacustre : village construit sur pilotis, dans
les temps préhistoriques, en bordure des lacs et des lagunes.
Clapet anti-retour : placé sur une canalisation,
il n'autorise le passage de l'eau que dans un seul sens. Ils sont
également installés après les compteurs d'eau
pour éviter toute pollution de l'eau du réseau public.
Clarification : la clarification est l'une des phases
du traitement de l'eau consistant à supprimer toutes les
matières visibles de l'eau. Elle comprend trois étapes
: la floculation, la décantation et la filtration.
C.L.E. : voir commision
locale de l'eau.
Climat : type de temps d'une région, connu en faisant
la moyenne des observations météorologiques de plusieurs
années. Pour déterminer le climat, on doit étudier
tous les éléments : humudité, précipitations,
pression, températures, vent.
Cloisonnement : ouverture linéaire dans les plantations
forestières pour faciliter les travaux d'entretien sylvicoles
ou les exploitations.
CODERST : Conseil Départemental de l'Environnement
et des Risques Sanitaires et Technologiques, organisme public chargé
de contrôler et de valider les déclarations d'utilité
publique des captages d'eau potable (anciennement Conseil Départemental
d'Hygiène).
Colibacille : bactérie en forme de bâtonnet
à l'extrimité arrondie, Gram négatif, présente
dans le sol, l'eau, le lait, certains aliments et qui vit normalement
dans l'intestin de l'homme et de l'animal mais peut devenir pathogène
pour d'autres organes. Escherichia
coli est le colibacille par excellence d'expérimentation
de la biologie moléculaire au cause de sa rapidité
de reproduction (un division cellulaire toutes les 20 minutes dans
les conditions adéquates).
Coliforme : les bactéries coliformes font parties
de la famille des entérobactéries,
c'est à dire que leur présence, normale dans l'intestin
de l'homme et de l'animal, peut devenir pathogène
pour d'autres organes. Les coliformes sont des bactéries
non sporulante et ayant la caractéristique de fermenter rapidement
le lactose avec un dégagement de gaz. Dans l'eau, les coliformes
sont des bacilles d'origine fécale ayant la forme et certaines
propriétés du colibacille.
On recherche en priorité les coliformes totaux dans l'eau,
puis une recherche de coliformes fécaux est ensuite engagée
si la présence de coliformes totaux est avérée.
La présence de coliformes fécaux dans l'eau (comme
Escherichia coli)
signifie qu'il peut y avoir des micro-organismes pathogènes
(comme les staphylocoques, les salmonelles, les entérovirus...)
dans le réseau, mais les coliformes fécaux sont peu
dangereux par eux mêmes.
Collectivité territoriale : les collectivités
territoriales sont des administrations indépendantes de l'Etat.
Elles sont définies par l'article 72 de la Constitution et
regroupent les communes, les départements, les régions,
les syndicats, les départements et les régions d'outre-mer,
les communautés de communes, d'agglomérations
et urbaines et les syndicats.
Certaines ont des statuts particuliers comme la Corse, Paris, Lyon,
Marseille ou la Polynésie. Elles sont gérées
suivant les dispositions du Code Général des Collectivités
Territoriales et sont toutes composées d'une assemblée
délibérante (conseil municipal ou conseil général)
élue au suffrage universel et d'un pouvoir exécutif
(le maire ou le président ) élu par cette même
assemblée en son sein.
Les collectivités territoriales sont dites
de droit commun et disposent de la libre administration. Elles sont
financièrement indépendantes de l'Etat, elles perçoivent
des impôts locaux (cas des communes et des départements),
des subventions ou des dotations de l'Etat dans le cadre de la décentralisation.
Elles sont définies par leur personnalité morale,
c'est à dire qu'elles peuvent agir en justice, leurs compétences
propres, leur propre pouvoir décisionnel qui s'exerce par
délibaration et un pouvoir exécutif propre. Elles
peuvent également avoir un pouvoir règlementaire dans
certains de leurs domaines de compétence. Par exemple, le
Syndicat de la Faye possède son propre règlement
pour sa compétence d'alimentation en eau potable.
Financièrement, les collectivités
territoriales sont organisées entre un ordonnateur
(le maire ou le président) qui signe les mandats de
paiements et les titres de recettes, et un comptable
(le percepteur ou le receveur du Trésor Public) qui procède
au règlement des paiements et à l'encaissement des
recettes. Le comptable est un représentant de l'Etat, il
contrôle donc les finances de la collectivité pour
le compte de l'Etat.
Les collectivités territoriales sont également
contrôlées au niveau administratif par la préfecture
de département, qui est une administration de l'Etat et qui
contrôle les délibérations et tous les choix
des collectivités. Il faut donc bien comprendre que l'Etat
agit uniquement en tant que contrôleur des collectivités
mais il ne peut, sauf cas exceptionnel comme une infraction au Code
Général des Collectivités Territoriales, imposer
une décision aux collectivités qui restent ainsi indépendantes
et libres de leurs choix.
En matière d'eau potable, on signalera
que les analyses
d'eau et les contrôles effectués par la D.D.A.S.S.
sont une autre forme de surveillance de l'Etat. De même, tous
les travaux du Syndicat de La Faye font l'objet d'une étude
réalisée par un ingénieur de la D.D.A.F.,
organisme de l'Etat, ceci afin que les constructions réalisées
sur l'ensemble du territoire français respectent une certaines
uniformité.
Colonne montante : dans un immeuble, canalisation, généralement
verticale, destinée aux branchements
individuels.
Comité de bassin : assemblée en liaison
avec une Agence de l'eau
composée d'élus, d'usagers et de représentants
de l'administration. Le Comité conçoit les plans d'assainissement,
arbitre les décisions et dispose d'un pouvoir financier (choix
des taux de redevance)
Commission locale de l'eau : commission de concertation
instaurée par la Loi sur l'eau de 1992 et instituée
par le Préfet, elle est chargée de l'élaboration,
de la révision et du suivi des Schémas
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.).
Sa composition est fixée par la loi et
précisée par décret (1/2 représentants
d'élus, 1/4 représentants d'usagers et 1/4 représentants
de l'Etat). Le Président doit être un membre du collège
des élus et ce sont ces derniers qui l'élisent.
Communauté : ce sont des collectivités
territoriales qui regroupent plusieurs autres communes. Les
communautés disposent d'une fiscalité propre et perçoivent
la taxe professionnelle à la place des communes adhérentes,
cette taxe est alors appelée la TPU (Taxe Professionnelle
Unifiée). Si la communauté est supérieure à
500 000 habitants, elle peut également bénéficier
de la taxe foncière et de la taxe d'habitation. Si la population
est inférieure à 500 000 habitants, elle peut bénéficier
de la taxe sur le foncier bâti et non bâti, et de la
taxe d'habitation.
Il existe 3 types de communauté :
• les Communautés
de Communes : créées en 1992, il en existe 2 343
en France, elles sont compétentes en matière de :
- développement
économique (obligatoire).
- aménagement
de l'espace (obligatoire).
-
environnement (facultatif).
- logement
et équilibre social (facultatif).
- voirie (facultatif).
- équipements
scolaires, culturels et sportifs (facultatif).
• les Communautés
d'Agglomération : créées en 1999, il en
existe 162 en France. Elles sont créées si la population
est supérieure à 50 000 habitants et si la commune
centre a une population supérieure à 15 000 habitants
(sauf s'il s'agit d'un chef lieu de département). Elles sont
compétentes en matière de :
- développement
économique (obligatoire).
- aménagement
de l'espace (obligatoire).
- logement
et équilibre social (obligatoire).
- politique
et développement de la ville (obligatoire).
- voirie (facultatif).
- assainissement
(facultatif).
- eau (facultatif).
- environnement
(facultatif).
- équipements
scolaires, culturels et sportifs (facultatif).
• les Communautés
Urbaines : créées en 1966, il en existe 14 en
France. Elles sont créées si la population est supérieure
à 500 000 habitants. Elles sont compétentes en matière
de :
- développement
économique (obligatoire).
- aménagement
de l'espace (obligatoire).
- logement
et équilibre social (obligatoire).
- politique
et développement de la ville (obligatoire).
- services
d'intérêt collectif (voirie, cimetières...)
(obligatoire).
- environnement,
eau et assainissement (obligatoire).
Sur le territoire du Syndicat de La Faye, il existe
2 communauté de communes : la Communauté de Communes
Thiers Dore et Montagne et la Communauté de Communes Ambert
Livradois Forez.
Commune : collectivité
territoriale reconnue dès 1789, il y a en 36 782 en France.
95% des communes ont moins de 5 000 habitants. Elle est administrée
par le conseil municipal (assemblée délibérante)
et le maire et ses adjoints
(pouvoir exécutif). La commune est compétente en matière
d'état civil, d'élections, d'éducation (école
primaire), voirie, signalisation des routes, aménagement,
ordre public, urbanisme, permis de construire, santé, économie,
culture et action sociale. Certains domaines de compétence
des communes peuvent faire l'objet de services publics communaux
avec section dédiée dans le budget communal comme
le service d'assainissement collectif, le service de collecte des
ordures ménagères, le service de santé et le
service d'alimentation en eau potable.
Compte administratif : c'est le budget
primitif définitif. Il est présenté par
la collectivité territoriale
à son comptable (le percepteur du Trésor Public) en
début d'année. Il présente le budget de l'année
précédente, ce qui a été dépensé
et ce qui a été encaissé. Il retrace toutes
les opérations financières de la collectivité
territoriale. Il doit correspondre au centime d'euros près
au compte de gestion du percepteur.
Compte de gestion : c'est le contrôle du budget réalisé
par le comptable de la collectivité
territoriale (le percepteur du Trésor Public). Il permet
à l'Etat de surveiller la gestion de la collectivité
territoriale. Le compte de gestion retrace l'exécution du
budget au cours de l'année précédente. Il est
présenté par le comptable à la collectivité
chaque début d'année. Il doit être identique
en tout point au compte administratif
présenté par la collectivité territoriale.
C'est un document de plusieurs pages.
Compteur combiné : deux compteurs sont associés
en parallèle pour comptabiliser les petits débits
comme les plus importants.
COMPTEUR COMBINE

|
Compteur d'eau : appareil présent chez chaque
usager, mesurant sa quantité d'eau consommée. Il est
d'un modèle agrée par la réglementation en
vigueur. Les compteurs d'eau froide doivent résister
à une pression de 10 bars. Ils sont classés en 3 catégories,
A, B et C allant du moins précis au plus précis. Les
compteurs d'eau des abonnés sont de la classe C. Au passage
de l'eau, un compteur provoque une perte de charge entraînant
une baisse de pression. Cette baisse ne doit pas être supérieure
à 0,25 bar au débit
nominal et à 1 bar au débit
maximal. Le choix du diamètre du compteur ne se fait
pas en fonction du diamètre de la canalisation mais en fonction
du débit maximal transitant dans la canalisation (le branchement
dans le cas d'un abonné). Un compteur d'eau est composé
de trois parties : le totalisateur qui indique l'index du compteur
(rouleaux ou aiguilles), la transmission (mécanique ou magnétique)
et enfin l'organe mesurant l'eau s'écoulant (piston, turbine,
hélice).
Compteur de vitesse : il en existe deux types, les compteurs
à turbine (à jet unique ou à jet multiple)
et les compteurs à hélice dit Woltmann (à hélice
vertical ou hélice axiale). Pour les compteurs à turbine,
l'eau s'introduit par un ou plusieurs orifices de la chambre du
compteur et entraîne la turbine dont la vitesse de rotation
est proportionnelle à la vitesse de l'eau. Conçus
pour des diamètres faibles, de 15 mm à 100 mm, ils
sont généralement de la classe B ou C et ne se posent
qu'en position horizontale. Dans les compteurs de vitesse à
hélice, la vitesse de rotation de l'hélice est proportionnelle
à la vitesse de l'eau. Ces compteurs sont conçus pour
de gros diamètre, de 50 mm à 800 mm et se posent en
position horizontale ou verticale pour les compteurs de vitesse
à hélice axiale. Le Syndicat de la Faye utilise la
plupart du temps des compteurs de vitesse à jets multiples,
que ce soit pour les compteurs des particuliers ou les compteurs
divisionnaires placés dans les réservoirs ou sur le
réseau de distribution d'eau potable. Si vous désirez
plus de précisions sur les compteurs qu'utilise le Syndicat
de la Faye sur le réseau d'eau potable vous pouvez télécharger
les documents suivants au format PDF ou vous rendre sur le site
internet de la société Actaris en cliquant ici.
compteur Flodis pour les particliers  (fichier
PDF de 304 ko) |
compteur Flostar pour le réseau  (fichier
PDF de 0,99 Mo) |
COMPTEUR DE VITESSE
A TURBINE A JET UNIQUE

|
COMPTEUR DE VITESSE
A TURBINE A JETS MULTIPLES

|
COMPTEUR DE VITESSE
A HELICE AXIALE

|
COMPTEUR DE VITESSE
A HELICE VERTICALE
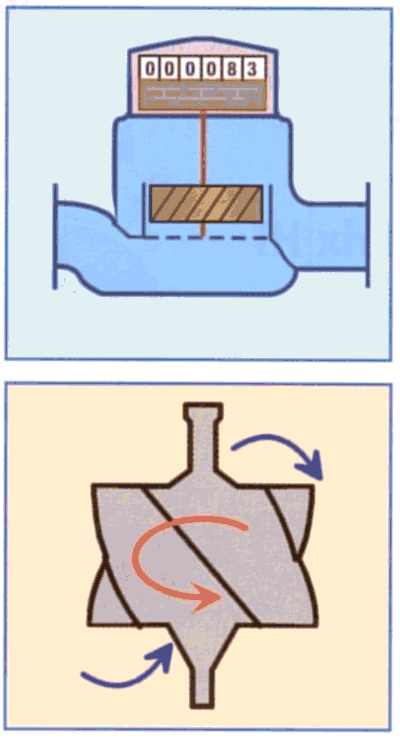
|
Compteur proportionnel : le compteur est placé en
parallèle de la canalisation principale. Le débit
traversant le compteur est proportionnel au débit passant
dans la conduite. Ces compteurs sont non homologués et utilisés
pour des diamètres nominaux allant de 65 à 500 mm.
Compteur volumétrique : il fonctionne à l'aide
d'un piston qui se déplace dans la chambre de mesure du compteur.
A chaque tour, un volume bien déterminé est libéré.
Les compteurs volumétriques démarrent à un
débit plus faible que les compteurs de vitesse et peuvent,
contrairement à la majorité des compteurs de vitesse,
être installés dans toutes les positions (verticale
et horizontale). Ce sont des compteurs de grande sensibilité
de classe C. Ils vont d'un diamètre nominal de 15 mm à
65 mm. Ils ont pour inconvénients d'être sensibles
aux coups de bélier,
d'être bruyants et de provoquer des pertes de charge importantes.
La présence de sable dans l'eau du réseau peut bloquer
le piston. Le Syndicat de la Faye n'utilise ce type de compteur
qu'en de rares occasions.
COMPTEUR VOLUMETRIQUE
A PISTON ROTATIF

|
Concession : obtenir une concession revient à
acquérir le droit d'exploitation de l'eau, accordé
par l'administration ou une collectivité
territoriale. Voir également délégation
de service.
Condensation : transformation de la vapeur d'eau en
particules d'eau plus denses (pluie, neige, grêle).
Conductivité : elle représente la minéralisation
d'une eau. Plus une eau contient de sels minéraux, plus sa
conductivité est grande. Son unité est le µS/cm.
En dessous de 180 µS/cm, une eau est considérée
comme peu minéralisée, elle est alors agressive.
Au-dessus de 1 000 µS/cm, une eau est considérée
comme fortement minéralisée, elle est alors entartrante.
L'eau du S.I.E.A. de La Faye a une conductivité qui varie
de 10 à 50 µS/cm, elle est de ce fait très peu
minéralisée. Pour plus de précisions, voir
la page Normes
de l'eau.
Cône : pièce de raccordement que l'on
emploie sur un réseau de canalisation de distribution d'eau
potable et qui permet de réduire le diamètre d'une
conduite.
Confluent : point de rencontre de deux cours d’eau.
Conforme : qui répond aux exigences d'une règle,
d'une norme.
Congélation : l'eau est congelée lorsqu'elle
passe de l'état liquide à l'état solide. L'eau
se congèle à 0°C.
Corrélation acoustique : méthode de
recherche de fuites mettant en oeuvre le principe de la capture
de signaux acoustiques émis par une fuite et se propageant
à vitesse égale sur la conduite. Très efficace
en milieu urbain, cette technique se base sur l'identification d'une
ressemblance entre deux signaux et la calcul du décalage
temporel entre ces deux signaux. L'appareil, relié par onde
radio à des capteurs placés sur les têtes de
vannes dans les bouches à clé, détermine la
distance entre la fuite et les capteurs et donc l'emplacement exact
de la fuite au centimètre près. Très efficace
sur les conduites métalliques, car le bruit de la fuite s'y
propage mieux, la corrélation acoustique l'est moins sur
la conduite en plastique.
CORRELATION ACOUSTIQUE

|
Consigne : dans une régulation, c'est la valeur
à laquelle on souhaite maintenir le paramètre régulé
(pression dans le cas d'un surpresseur).
Consommation domestique : somme des volumes facturés
à tous les abonnés d'une collectivité consommant
moins de 6 000 m3 par an rapportés
au nombre d'habitants de la collectivité. Inclut les consommations
résidentielles mais aussi les consommations de commerces
et locaux commerciaux, petits usages communaux, usages artisanaux,
petits immeubles de bureau, etc. (Définition par opposition
aux gros abonnés consommant 6 000 m3
d'eau par an et plus).
Consommation nette : fraction du volume d'eau superficielle
ou souterraine, prélevée et non restituée au milieu aquatique (rivière
ou nappe), c'est à dire non rejetée après usage (eau consommée par
les plantes et évapotranspiration, évaporation,...).
Consommation résidentielle : somme des volumes
facturés aux lieux d'habitation (immeubles collectifs et
maisons individuelles) rapportés au nombre d'habitants. Peut
inclure quelques commerces de pied d'immeubles collectifs.
Contrat de rivière : programme d'action sur
5 ans destiné à restaurer et à valoriser une rivière et son bassin
versant. Cette procédure volontaire, concertée, coordonnée sur un
périmètre d'intervention cohérent a pour principaux volets :
la restauration de la qualité des eaux et des milieux (berges, lit,...),
la mise en valeur des milieux aquatiques, des paysages, la gestion
équilibrée des ressources en eau, un programme et une organisation
d'entretien, le suivi du contrat. Il se présente sous la forme d'un
contrat signé entre le Préfet ou les Préfets de département, le
Directeur de l'Agence de l'Eau du bassin et les élus du département
et/ou du sous-bassin concerné, le Président du Conseil Général,
les Présidents de syndicats intercommunaux, ainsi que tout autre
intervenant principal à la gestion du cours d'eau. Ce contrat comprend
des engagements financiers précis.
Contrôle sanitaire des eaux : contrôle
portant sur toutes les eaux destinées aux usages et ayant
une incidence sur la santé publique (eau potable, baignade,
abreuvement...), et qui vérifie leur conformité à
des exigences réglementaires sur le plan de la consommation
ou de l'hygiène humaine et animale (normes O.M.S....).
Les lieux de prélèvement des échantillons
et les méthodes analytiques de référence utilisées
pour ce contrôle sont déterminées par les autorités
nationales compétentes (Ministère chargé de
la santé, chargé de l'agriculture...).
Le contrôle sanitaire correspond
au contrôle de la qualité des eaux d'alimentation réalisé
par les D.D.A.S.S.. Chaque
année près de 320 000 prélèvements d'échantillons
d'eau sont effectués dans les systèmes de production
et de distribution d'eau. Ces échantillons sont ensuite analysés
par des laboratoires agréés par le ministère
chargé de la Santé, ce qui représente annuellement
quatre millions de paramètres mesurés dans l'eau par
an. Cette action de contrôle est effectuée directement
par les pouvoirs publics indépendamment de la surveillance
exercée par les distributeurs d'eau privés et publics.
Les résultats des analyses sont évalués et
comparés à des exigences de qualité fixées
par la réglementation
française, prises en application de directives européennes.
En cas de dépassement des exigences de
qualité, et au vu des enjeux sanitaires, des mesures correctives
sont mises en oeuvre pour rétablir la qualité des
eaux d'alimentation. Dans la pratique, ces situations urgentes et
ponctuelles requièrent l'expertise des D.D.A.S.S..
Par ailleurs, s'agissant de l'information du public, une synthèse
annuelle sur la qualité des eaux distribuées l'année
précédente, rédigée par la D.D.A.S.S.,
est jointe à la facture d'eau et donc directement transmise
à l'abonné.
Convention d'Aarhus : signée à Aahrus, au Danemark,
le 25 juin 1998 sous l'égide de la Commission économique pour l'Europe
de l'Organisation des Nations Unies (U.N.E.C.E.), cette convention
porte sur l'accès à l'information, la participation du public au
processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement.
Corrélation acoustique : méthode utilisée
en recherche de fuites pour les localiser
avec précision. La méthode consiste à capter
en 2 points différents et accessibles de la conduite (au
niveau des vannes sur la conduite au fond des bouches à clé),
le bruit émis par la fuite. Le principe d'analyse des bruits
est le suivant : pour retrouver une ressemblance entre les signaux
qui résultent du bruit de fuite en deux points différents
de la conduite, il faut faire subir à l'un deux toute une
série de décalages dans le temps qui compense exactement
la différence des temps de propagation du point de fuite
aux deux points d'accès à la conduite.
Il s'agit donc de placer 2 capteurs en contact avec la canalisation
sur 2 points d'accès distincts et assez distants (au moins
quelques dizaines de mètres, au plus quelques centaines).
Après paramètrage du corrélateur, le bloc de
traitement analyse les bruits, lmes compare, mesure leur décalage
et calcule la distance entre le point de fuite et l'un des capteurs.
Le résultat du traitement, réalisé par le corrélateur,
donne simultanément la détection de la fuite (ressemblance
des signaux) et sa localisation (repérage du décalage
qui a permis de retrouver cette ressemblance).
Corrosive : voir agressive.
Couche de Tillmans : légère couche de
tartre qui se forme à
l'intérieur des canalisations d'alimentation en eau potable
par précipitation de carbonate de calcium CaCO3.
Cette couche, provoquée par les distributeurs d'eau qui maintiennent
volontairement la dureté
de l'eau à un certain niveau, permet de protéger l'intérieur
des conduites d'eau.
Coude : pièce de raccordement que l'on emploie
sur un réseau de canalisation de distribution d'eau potable
en forme de L et qui permet de changer la direction d'une conduite.
Coup de bélier : augmentation soudaine de
la pression dans les
canalisations de distribution d'eau potable. Les coups de bélier
peuvent entraîner une détérioration des appareils
hydrauliques comme les compteurs d'eau par exemple, et provoquer
des fuites. Sur un réseau d'eau potable, on utilise des régulateurs
de pression pour maintenir une pression stable de l'eau dans
les canalisations. Mais il peut arriver qu'il y ai des augmentations
fortes de la pression,
lors d'une ouverture de vanne trop rapide par exemple. Dans ce cas,
on utilise une soupape anti-bélier dont le fonctionnement
vous est expliqué par le schéma suivant :
|
|
Principe de fonctionnement d'une soupape anti-bélier
Modèle : GD (Ramus
Industrie)
|
|
Coût : aujourd'hui, la facture
d'eau couvre le coût de toutes les opérations successives
qui sont nécessaires pour capter l'eau, la rendre potable,
la stocker, la distribuer, l'évacuer et la dépolluer
avant de la renvoyer d'où elle vient. Dans ce prix,
la part de la fourniture d'eau tend à diminuer au profit
du service de l'évacuation et de la dépollution.
Cette part augmentera d'aileurs au fur et à mesure que
les contraintes de dépollution se renforceront. Il ne faut
toutefois pas oublier qu'une tonne d'eau (un mètre cube
soit mille litres) montée au sixième étage,
puis redescendue, coûte aujourd'hui à peu près
mille fois moins que ce qu'aurait demandé un porteur d'eau
pour effectuer le même travail.
Crue : débordement subit d'une rivière
ou d'un fleuve après les pluies.
Cryptosporidium : parvum, protozoaire
pathogène chez l'homme, il est responsable d'infections
parasitaires intestinales plus ou moins graves dénommées
giardiose. Chez les personnes immuno-déprimées (nouveau-nés,
personnes agées, personnes immuno-déficientes),
ces infections parasitaires peuvent avoir des conséquences
mortelles. Ce protozoaire est libéré dans l'environnement
par les animaux et les humains infectés. La transmission
chez l'homme se fait au contact d'animaux, soit par l'ingestion
d'aliments et/ou d'eau contaminée. Ce micro-organisme existe
sous deux formes : une forme végétative infectante
qui ne survit que quelques heures après émission
des selles et une forme kystique survivant plusieurs semaines
dans l'environnement. Sa forme infectieuse ne prolifère
pas dans l'environnement. Ce micro-organisme se retrouve principalement
dans les eaux de surface et les eaux souterraines contaminées
par des eaux de surface. Son élimination est très
compliqué car il est très résistant aux désinfectants
comme le chlore ou le dioxyde de chlore et l'ozone. Seule la filtration
membranaire permet un fort abattement de ce protozoaire.
Cumulus : nuage qui se forme en hauteur.
Curage "vieux fonds - vieux bords" : le
curage "vieux fonds - vieux bords" est l'expression consacrée
des anciens règlements et usages locaux qui précisent les conditions
et la périodicité avec lesquelles doit être remplie l'obligation
de curage faite à chaque riverain d'un cours d'eau non domanial
par l'article 98 du Code rural. Il constitue un entretien courant
de la rivière par le riverain ou son ayant droit. On dit parfois
"vifs fonds - vieux bords".
Cyanophycées : type d'algues que l'on peut
retrouver dans les étendues d'eau. Elles ont la particularité
de relarguer des toxines hépatiques, des neurotoxines ou
des endotoxines. Ce sont les espèces d'algues les plus
difficiles à éliminer.
Cycle de l'eau : grâce à l'énergie
thermique qu'il déploie, le soleil arrache de l'eau aux
océans et la transforme en vapeur. Le vent emporte ces
nuages plus loin, sur les continents, où ils crèvent
sous forme de précipitations. Ces pluies sont ensuite rendues
à la mer par la voie directe des rivières ou par
le chemin des écoliers que sont les nappes.
Toutefois, l'évaporation (à laquelle s'ajoute la
transpiration des végétaux) joue les trouble-fêtes
et fait remonter directement dans l'atmosphère la majorités
des gouttes d'eau, sans leur laisser le temps d'aller faire un
tour en mer. Bien entendu, cette part d'évaporation pourra
varier fortement selon les climats et les périodes de l'année.
En moyenne, le bilan de la petite ronde terrestre s'établit
ainsi :
la pluie (100 %) = l'évaporation (65
%) + l'écoulement des rivières (24 %) + l'infiltration
et l'écoulement dans les nappes souterraines (11 %).
Quelle que soit la manière dont elle
circule, la masse d'eau de la Terre reste quasi constante et les
trois fractions eau, vapeur, glace s'échangent à
leur tour dans un cycle perpétuel à l'intérieur
de la grande ronde.
|