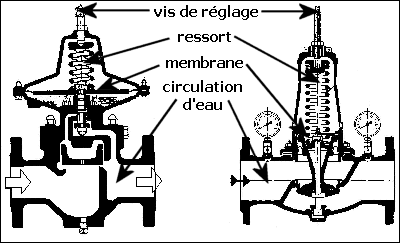|
| |
| En vous baladant sur ce site,
vous pouvez tomber sur un mot dont vous ne comprenez pas très
bien le sens. Heureusement, le Dic'eau est là pour vous aider!
Cliquez sur un des liens ci-dessous pour aller directement à
la lettre par laquelle commence le mot qui vous pose problème. |
| |
|
|
| |
|
|
| |
P.A.D.D. : voir Projet
d'Aménagement et de Développement Durable.
Parasite : être vivant qui puise
les substances qui lui sont nécessaires dans l'organisme
d'un autre (hôte), auquel il cause un dommage plus ou moins
grave. On peut retrouver des parasites dans l'eau potable si la
désinfection est insuffisante.
Participation du public : démarche, prévue par la
directive cadre sur l'eau, d'implication du public dans le processus
de sa mise en application. Elle inclut notamment la réalisation
de consultations du public sur :
- le programme de travail de la révision
du S.D.A.G.E.,
- les questions importantes sur le bassin hydrographique,
- le projet de S.D.A.G.E..
Participation pour voirie et réseaux : la P.V.R.
est une mesure instaurée par la loi Urbanisme
et Habitat de 2003 et qui autorise les petites communes à
faire participer directement les habitants de la commune au financement
des travaux de voirie et de réseaux divers. La P.V.R. est
instituée par délibération du Conseil Municipal
avec un barème forfaitaire de paiement au prorata de la surface
du terrain desservi par la voie ainsi aménagée.
Particules colloïdales : particules très
petites en suspension dans un liquide. Par exemple, le lait est
constitué d'eau et de particules colloïdales, on dit
que c'est une suspension
colloïdale.
Passe à poisson : dispositif implanté sur un
obstacle naturel ou artificiel (barrage) qui permet aux poissons
migrateurs de franchir ces obstacles pour accéder à leurs zones
de reproduction ou de développement. On distingue des dispositifs
de montaison et de dévalaison. D'autres équipements de franchissement
parfois assimilés à des passes à poissons sont par exemple des ascenseurs
à poisson, des écluses particulières,...
Pasteuriser : stériliser par échauffement
(à environ 80 °C).
Pathogène : se dit d'une bactérie qui
peut engendrer une maladie.
Patrimoine : (au sens d’eau patrimoniale),
terme employé dans l'article 1 de la loi sur l'eau pour insister
sur la nécessité de préserver la richesse,
le capital ressource existant, pour les générations
futures.
Pédologie : du grec "pedon", sol
et "logos", discours. La pédologie étudie
les sols, leur formation et leur évolution, afin d'en effectuer
le classement.
Percolation : pénétration lente des
eaux de pluie dans le sol.
Périmètre de protection de captage d'eau potable
: limite de l'espace réservé réglementairement
autour des captages utilisés pour l'alimentation en eau potable,
après avis d'un hydrogéologue agréé,
afin de préserver la qualité de l'eau captée.
Les activités artisanales, agricoles et industrielles, les
constructions y sont interdites ou réglementées afin
de préserver la ressource en eau, en évitant des pollutions
chroniques ou accidentelles. C'est la circulaire
du 24 juillet 1990 relative à la mise en place
des périmètres de protection qui fixe les modalités
d'application de chaque périmètre. Ainsi, on peut
distinguer réglementairement trois périmètres
:
- le périmètre
de protection immédiate (P.P.I.) où les contraintes
sont fortes avec possibilités d'interdiction d'activités.
Il a pour fonctions d'empêcher la détérioration
des ouvrages de prélèvements et d'éviter que
des déversements ou des infiltrations de substances polluantes
se produisent à l'intérieur ou à proximité
immédiate des ouvrages de captages. Des périmètres
"satellites" de protection immédiates, disjoints
de celui du captage concerné, peuvent être instaurés
autour des zones d'infiltration (pertes, gouffres, bétoires)
en relation hydrogéologique directe avec les eaux prélevées.
Les zones ainsi définies seront également acquises
en pleine propriété et clôturées. Un
aménagement correct et un entretien efficace des ouvrages
de captage complètent cette première mesure de protection.
- le périmètre
de protection rapprochée (P.P.R.) où les activités
sont restreintes. Il doit protéger efficacement le captage
vis à vis de la migration souterraine des substances polluantes.
Son étendue est déterminée en prenant en compte
: les caractéristiques physiques de l'aquifère
et de l'écoulement souterrain, le débit
maximal de pompage, la vulnérabilité, l'origine et
la nature des pollutions contre lesquelles il est nécessaire
de protéger les eaux souterraines. Les notions de base à
retenir pour délimiter ces périmètres sont
d'une part, la durée et la vitesse de transfert de l'eau
entre les points d'émission de pollutions possibles et le
point de prélèvement dans la nappe. D'autre part,
le pouvoir de fixation et de dégradation du sol et du sous-sol
vis-à-vis des polluants. Et enfin, le pouvoir de dispersion
des eaux souterraines. Dans des situations complexes, le périmètre
de protection rapprochée peut comporter plusieurs zones,
disjointes ou non, délimitées suivant la vulnérabilité
de l'aquifère.
- le périmètre
de protection éloignée (P.P.E.) pour garantir
la sécurité de la ressource. Il prolonge éventuellement
le périmètre de protection rapprochée pour
renforcer la protection contre les pollutions permanentes ou diffuses.
Il est créé si l'on considère que l'application
de la réglementation générale (même renforcée)
n'est pas suffisante, en particulier s'il existe un risque potentiel
de pollution que la nature des terrains traversés ne permet
pas de réduire en toute sécurité, malgré
l'éloignement du point de prélèvement. Les
limites de ce périmètre peuvent s'étendre sur
des distances importantes pour couvrir des bassins hydrogéologiques
parfois différents.
Des prescriptions sont énoncées
pour chaque périmètre et se traduisent par des servitudes
pouvant donner droit à des indemnisations. Certaines peuvent
relever simplement de la réglementation générale
pour laquelle toute indemnisation est exclue.
|
|
 Périmètres de protection d'un captage d'eau
potable
Périmètres de protection d'un captage d'eau
potable |
|
Périmètre du S.A.G.E. : délimitation
géographique du champ d'application d'un schéma
d'aménagement et de gestion des eaux (S.A.G.E.). Ce périmètre
s'inscrit à l'intérieur d'un groupement de sous-bassins
ou d'un sous-bassin correspondant à une unité hydrographique
ou à un système aquifère. Il est déterminé
par le schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux (S.D.A.G.E.) ou
à défaut arrêté par le représentant
de l'Etat aprés consultation ou sur proposition des collectivités
territoriales et aprés consultation du comité de bassin.
Périmètre sourcier : délimitation
de la zone comprenant les pavillons de captage coiffant les points
d'émergence et/ou les galeries captantes qui interceptent
l'eau en circulation sous terre.
Période d'étiage : période où
l'on observe un débit d'étiage.
Perméabilité : aptitude d'une roche
ou d'un sol à se laisser traverser par un fluide liquide
ou gazeux.
Personnalité morale : groupement de personnes
ou de biens ayant, comme une personne physique c'est à dire
un être humain, la personnalité juridique et qui peut
donc s'inscrire en justice pour tout acte que se soit ou à
l'inverse, il peut être poursuivi denvant un tribunal. La
personnalité morale est doté de moyens matériels
et personnels, et elle relève du droit public ou privé.
Le Syndicat de la Faye est doté de la personnalité
morale et relève du droit public.
Perte de charge : c'est la perte de pression que l'on
observe dans un tuyau ou une canalisation au fur et à mesure
que l'on s'éloigne du point d'alimentation en eau. Elle est
causée par les frottements de l'eau contre les parois. Elle
est plus faible dans les tuyaux neufs (bien lisses à l'intérieur)
que dans les tuyaux usagés.
La perte de charge (exprimée en hauteur
d'eau) dans un tuyau est :
- proportionnelle au périmètre
intérieur et à la longueur du tuyau,
- proportionnelle au carré
de la vitesse moyenne de l'eau en m/s,
- inversement proportionnelle
à la surface de la section droite du tuyau.
D'où il découle que la perte de charge est moindre
dans un tuyau de forte section, car la section varie plus vite que
le périmètre en fonction du diamètre.
Plus les pertes de charges augmentent et plus le débit diminue.
Pesticides : ce terme regroupe les herbicides, fongicides,
insecticides. Ce sont des substances chimiques utilisées
pour la protection des cultures contre les maladies, les insectes
ravageurs ou les "mauvaises herbes". Voir également
les normes
de l'eau.
pH : potentiel hydrogène. Le pH caractérise
la concentration d'une eau ou d'une solution aqueuse en ions
hydronium (H+). Plus simplement, il
mesure l'acidité ou l'alcalinité d'une eau. Le pH
des eaux naturelles est lié à la nature géologique
des terrains traversés. En régions granitiques (comme
c'est le cas en Auvergne) ou schisteuses, en zones de tourbières
ou forestières, les eaux ont un pH acide (< 7). En régions
calcaires, les eaux ont un pH basique (> 7). Les valeurs du pH
varient de 0 à 14. Une eau à pH = 7 est une eau neutre
(comme pour l'eau distillée par exemple). Le pH acide
est sans conséquence directe sur la santé (des boissons
comme le soda ou le jus de citron ont un pH acide). C'est le temps
de séjour de l'eau dans les canalisations métalliques
(plomb, cuivre, fonte...) qui crée le risque. Pour plus de
précisions, voir la page normes
de l'eau.
Phosphates : éléments provenant soit
d'engrais chimiques soit des eaux usées, qui favorisent l'engraissement
de l'eau. Certains pays ont interdit les lessives avec phosphates
pour se prémunir contre ce risque.
Photosynthèse : chez les végétaux
chlorophylliens, la photosynthèse correspond à la
fabrication de matières oragniques (des hydrates de carbones)à
à partir de matière minérale et de l'énergie
lumineuse d'origine solaire. L'intensité de la photosynthèse
croît avec l'intensité de la lumière.
Phytoplancton : ensemble des organismes végétaux
microscopiques qui vivent en suspension dans '’eau (algues…).
Phytosanitaire : relatif au soin à donner aux
végétaux, les produits phytosanitaires, utilisés
notamment en agriculture, sont destinés à la protection
ou à l'amélioration de la production agricole.
Plan d'alerte : document prévu pour répondre le plus
rapidement et le plus efficacement à un danger lié à l'eau (pollution
accidentelle, crue, sécheresse,...). Le plan d'alerte est sous la
responsabilité du Préfet.
Plan d'exposition aux risques naturels prévisibles
(P.E.R.) : plan qui a pour objet de délimiter, à l'échelle
communale, voire intercommunale, des zones exposées aux risques
naturels prévisibles tels les tremblements de terre, les inondations,
les avalanches ou les mouvements de terrain. Ainsi fixe-t-il les
mesures aptes à prévenir les risques et à en réduire les conséquences
ou à les rendre supportables, tant à l'égard des biens que des activités
implantés ou projetés. Il lui appartient, en particulier, de déterminer
les dispositions à prendre pour éviter de faire obstacle à l'écoulement
des eaux et de restreindre d'une manière nuisible les champs d'inondation.
Le P.E.R. constitue un document de prévention à finalité spécifique
établi à l'initiative du Préfet. Les P.E.R. valent plan de prévention
des risques naturels prévisibles (P.P.R.) en application de la Loi
du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement.
Plan d'intervention : document qui détermine les mesures
à prendre face à une crise majeure (pollutions accidentelles ou
événements catastrophiques), et qui vise à planifier les secours,
organiser la circulation d'informations entre les services concernés,
informer le public avec les consignes nécessaires, délimiter éventuellement
le zones d'évacuation, etc. Ce plan prévoit la mise à jour d'un
certain nombre de cartes et d'inventaires (liste de captages, prises
d'eau, etc.). Les plans particuliers d'intervention (P.P.I.), déterminés
à partir des types d'accidents possibles et de scénarii préétablis
(risques industriels notamment), décrivent les mesures qui incombent
au pollueur et que celui-ci doit prendre avant l'intervention de
l'autorité de police. On parle le plus souvent de plan départemental
d'intervention (annexé au plan O.R.S.E.C. départemental).
Plan de gestion : document de planification établi
à l'échelle de chaque district, pour 2009. En France, l'outil actuel
de planification de la gestion des eaux est le S.D.A.G.E.. Il sera
révisé afin d'intégrer les objectifs et les méthodes de la directive
cadre.
Plan de prévention des risques naturels prévisibles
(P.P.R.) : document qui délimite les zones exposées aux
risques (inondation, mouvement de terrain, avalanches,...) et définit
des mesures de prévention, protection et sauvegarde des personnes
et des biens vis-à-vis de l'impact néfaste des événements exceptionnels.
Ce plan est arrêté par le Préfet après enquête publique et avis
des conseils municipaux des communes concernées. Il est annexé au
P.O.S. (Plan d'Occupation des Sols). Sa procédure d'élaboration
est plus légère que celle des plans existants auparavant (Plan d'Exposition
au Risque (P.E.R.), Plan de Surface Submersible (P.S.S.)). Des sanctions
sont prévues en cas de non application des prescriptions du plan.
Plan de surface submersible (P.S.S.) : document instaurant
une servitude d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
Il permet à l'administration de s'opposer à toute action ou ouvrage
susceptibles de faire obstacle au libre écoulement des eaux ou à
la conservation des champs d'inondation. Les P.S.S. vaudront plan
de prévention des risques naturels prévisibles à compter de la publication
du décret prévu à l'article 40-7 de la Loi "Barnier".
Plan local d'urbanisme (P.L.U.) : c'est un outil de
gestion qui organise le cadre de vie à l'intérieur
d'une commune. Il dessine le visage de la ville de demain en conciliant
les intérêts locaux et communaux. C'est un outil réglementaire,
qui définit et règle l'usage des sols sur l'ensemble
du territoire d'une commune. Il concerne toutes les parcelles, qu'elles
soient privées ou publiques. Il détermine notamment
les droits à construire et les conditions d'évolution
attachés à chaque parcelle d'une commune. Ce document
juridique, de portée générale, s'impose à
tous, particuliers et administrations. Il sert de référence
obligatoire à l'instruction des demandes d'occupation et
d'utilisation du sol, comme par exemple les permis de construire.
Il est élaboré par la commune de sa propre initiative.
Le Plan Local d'Urbanisme doit respecter les règles fixées
par le Schéma de Cohérence
Territoriale (S.Co.T.).
Son contenu est défini par le Code de l'Urbanisme
et comprend obligatoirement cinq types de pièces :
• le rapport de présentation,
il expose le diagnostic du territoire communautaire et explique
les choix retenus pour le projet d'aménagement et de développement
durable, son impact sur l'environnement.
• le projet d'aménagement
et de développement durable, il comporte les orientations
générales d'aménagement et d'urbanisme retenues.
Le P.A.D.D. peut en outre comporter des orientations
plus ciblées sur telle ou telle partie du territoire communautaire.
• le règlement,
il définit en quatorze articles pour chaque zone quel type
d'occupation des sols est autorisé, comment aménager
ou construire une parcelle, quelles sont les règles applicables
pour construire un terrain donné. Par exemple, il peut être
défini des zones urbaines (U) ou à urbaniser (Ua),
des zones agricoles (A) ou naturelles (N) inconstructibles.
• les documents graphiques,
ils indiquent le champ d'application du règlement par le
délimitation de zones et la localisation des différentes
prescriptions graphiques. Ces plans sont opposables aux tiers.
• les annexes, elles
comprennent des pièces obligatoires relatives aux servitudes
d'utilité publique, aux emplacements réservés,
aux périmètres de risques…
Plan sanitaire départemental : le règlement
sanitaire départemental constitue le texte de référence
pour imposer des prescriptions en matière d’hygiène
et de salubrité aux activités qui ne relèvent
pas du champ d’application de la loi du 19 juillet 1976. En
effet, les dispositions du plan sanitaire départemental cessent
d’être applicables dès lors que les activités
visées rentrent dans la nomenclature des installations classées
pour la protection de l’environnement. Les plans sanitaires
départementaux, pris par les préfets sur le modèle
du règlement type, ont force contraignante et leur violation
constatée peut entraîner des peines d’amende en
répression des infractions. Le règlement sanitaire
départemental comprend 9 titres :
• eaux d’alimentation,
• locaux d’habitation et assimilés,
• dispositions applicables aux bâtiments
autres que ceux à usage d’habitation et assimilés,
• élimination des déchets et
mesures de salubrité générale,
• bruit,
• mesures visant les malades contagieux,
leur entourage et leur environnement,
• hygiène de l’alimentation,
• prescriptions applicables aux activités
d’élevage et autres activités agricoles,
• dispositions diverses.
Plan Vigipirate : suite aux récents évènements
intervenus dans l'actualité internationale, ce plan prévoit
notamment de mettre en oeuvre des mesures de protection des installations
de production et de distribution d'eau destinée à
la consommation humaine. Il concerne l'ensemble des collectivités
et des responsables des installations de traitement et de distribution.
Les mesures à prendre sont :
1 - mettre en place une procédure
de surveillance des actes suspects en établissant un registre
des plaintes d'usagers et autres évements douteux apparaissant
sur le réseau, en sensibilisant le personnel à la
prévention des risques et en contrôlant les stocks
de réactifs.
2 - vérifier de manière générale
les clôtures et les accés aux ouvrages du réseau
et mise en place de systèmes de détection d'intrusion
dans les ouvrages et dans les bâtiments.
3 - identifier et enregistrer tous les intervenants
sur toutes les installations du réseau y compris les visiteurs
lors des manifestations portes ouvertes. Analyser toutes les consommations
anormales et mettre en place un système de chloration.
4 - mettre en place un plan de communication
rapide auprés des abonnés, de la préfecture
et des services de la D.D.A.S.S..
5 - actions relatives au système
de chloration.
6 - renforcer l'inspection des installations
jugées à risque par des rondes de surveillance, par
un système de télésurveillance et par des détecteurs
d'intrusions. Informer les forces de l'ordre de la localisation
des installations sensibles.
7 - augmenter le nombre d'analyses d'auto-surveillance
de la qualité de l'eau.
8 - vérifier le bon fonctionnement
des interconnexions de réseaux.
9 - suspension des manifestations "portes
ouvertes" et des visites d'ouvrages.
10 - mise en place de permanence des services.
11 - constitution de stock d'eau potable de secours.
Vous pouvez retrouver plus de renseignements concernant
le plan Vigipirate et les modalités appliquées par
le Syndicat de la Faye en allant sur la page sécurité
du site.
Planète : corps céleste sans lumière
propre qui tourne autour d'une étoile. La Terre est une planète
qui tourne autour du Soleil et qui profite de sa chaleur, de sa
lumière et de son énergie.
Plomb : métal dense, d'un gris bleuâtre.
On le trouve dans la nature surtout à l'état de sulfure.
P.L.U. : voir Plan Local d'Urbanisme.
Pluie : eau qui tombe du ciel.
Pluie cévénole : se dit d'une pluie
violente qui s'abat très rapidement, comme dans les Cévennes
à l'automne ou au printemps. Des pluies de type cévenol
peuvent se produire n'importe où et à n'importe quelle
saison.
Pluie efficace : les pluies (ou précipitations)
efficaces, exprimées en millimètres, sont égales
à la différence entre les précipitations totales
et l'évapotranspiration.
Les précipitations efficaces peuvent être calculées
directement à partir des paramètres climatiques et
la réserve utile
du sol. L'eau des précipitations efficace est répartie,
au niveau du sol, en deux fractions : l'écoulement
superficiel et l'infiltration.
Pluies acides : retombées de pluies chargées
en acides (sulfuriques, nitriques, chlorhydriques) qui ont été
lessivés dans l'atmosphère par l'eau.
Pluvial : qui provient de la pluie.
Pluviomètre : instrument permettant de mesurer
la quantité de pluie tombée en un lieu et un temps
donné.
Pluviométrie : hauteur d'eau de précipitations
en un lieu.
Point nodal : point clé pour la gestion des
eaux défini en général à l'aval des
unités de références hydrographiques pour les
S.A.G.E. et/ou à
l'intérieur de ces unités dont les contours peuvent
être déterminés par les S.D.A.G.E..
A ces points peuvent être définies en fonction
des odjectifs généraux retenus pour l'unité,
des valeurs repères de débit et de qualité.
Leur localisation s'appuie sur des critères de cohérence
hydrographique, ecosystèmique, hydrogéologique et
socio-économique.
Pollution : dégradation d'un milieu naturel
par des déchets, des substances chimiques, une élévation
de température…. Cette dégradation entraîne
des dommages, des déséquilibres ou des effets nocifs
et porte atteinte au bien-être des organismes vivants.
Pollution de l'eau : rejet de substances ou d'énergie
effectué ou non par l'homme dans le milieu aquatique, directement
ou indirectement, et ayant des conséquences de nature à
mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources
vivantes et au système écologique aquatique, à
porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres
utilisations légitimes des eaux.
Pollution diffuse : pollution dont la ou les origines
peuvent être généralement connues mais pour
lesquelles il est impossible de repérer géographiquement
l'aboutissement dans les milieux aquatiques et les formations aquifères.
Pollution dispersée : ensemble des pollutions
provenant de plusieurs ou de nombreux sites ponctuels. Elle est
d'autant plus préjudiciable que le nombre de sites concernés
est important.
Pollution ponctuelle : pollution provenant d'un site
identifié, par exemple point de rejet d'un effluent, par opposition
à la pollution diffuse...
Pollution toxique : pollution par des substances à
risque toxique qui peuvent, en fonction de leur teneur, affecter
gravement et/ou durablement les organismes vivants. Ils peuvent
conduire à une mort différée ou immédiate, à des troubles de reproduction,
ou à un dérèglement significatif des fonctions biologiques. Les
principaux toxiques rencontrés dans l'environnement lors des pollutions
chroniques ou aiguës sont généralement des métaux lourds (plomb,
mercure, cadmium, zinc,...), des halogènes (chlore, brome, fluor,
iode), des molécules organiques complexes d'origine synthétique
(pesticides,...) ou naturelle (hydrocarbures).
Polymérisation : réaction chimique consistant
en l'union de molécules d'un même composé (monomère)
en une seule molécule plus grosse appelée polymère.
Cette réaction peut être accélérée
par les hydrures de bore susceptibles de se retrouver dans l'eau.
Pompage : action de puiser, aspirer l'eau avec une
pompe.
Porosité : capacité d'une roche liée
à contenir l'eau, à la présence de pores qui
la constituent.
P.O.S. : Plan d'Occupation des Sols. Il est dorénavant
remplacé par le P.L.U..
Il définit à l'échelle d'une commune l'aménagement
possible des parcelles cadastrales dans le but d'orienter la politique
d'urbanisme de cette commune.
Potable : qui peut être bu sans danger.
Potassium : métal alcalin extrait de la potasse,
léger, mou et très oxydable.
Poteau incendie : il permet aux services de lutte
contre l'incendie (pompiers) de puiser l'eau du réseau. Un
poteau incendie est constitué de quatre parties :
- un corps peint en rouge équipé
de trois prises normalisées, habillé ou non d'un coffre,
- un tube allonge enterré,
- un coude à patin avec raccord à
brides,
- un clapet et son dispositif de commande.
Un carré de manoeuvre commande, par l'intermédiaire
d'une vis et d'un tube de manoeuvre, l'ouverture et la fermeture
du clapet. Afin de supprimer les risques de gel, les poteaux incendie
doivent être munis d'un dispositif de vidange. Lorsque l'on
ferme le poteau, l'eau contenue dans la colonne doit s'évacuer
automatiquement.
En zone urbaine, les poteaux incendie doivent être installés
tous les 200 m. Il est obligatoire qu'ils soient de couleur rouge
(norme NFS 61-213 et NFS 62-200). Cette couleur, dite "rouge
incendie" fait elle-même l'objet d'une norme (NFX 08-008).
Il existe des poteaux renversables équipés d'un dispositif
permettant de préserver l'étanchéité
du poteau en cas de choc accidentel, éviant ainsi tout geyser.
Deux diamètres sont utilisés en France :
- DN 100 avec 1 prise de 100 mm et 2 prises
de 65 mm - 60 m3/h - pression résiduelle
1 bar - fermeture dans le sens horaire 13 ± 0,5 tours.
- DN 150 avec 1 prise de 65 mm et 2 prises
de 100 mm - 120 m3/h - pression résiduelle
1 bar - fermeture dans le sens horaire 17 ± 0,5 tours.
Pourcentage de chlore actif : symbole % c.a.. Il représente
la masse (en gramme) de chlore gazeux libérée par
100g de produit. Exemple : 100 grammes d'une solution à 2
% de chlore actif génèrent 2 g de chlore gazeux.
P.P.E. : Périmètre de Protection Eloignée,
voir périmètre de protection.
P.P.I : Périmètre de Protection Immédiate,
voir périmètre de protection.
P.P.R. : Périmètre de Protection Rapprochée,
voir périmètre de protection.
Pralinage : trempage des plants d'arbres dans une
solution d'éléments fertilisants et de matières
organique.
Précipitation : eau contenue dans l'atmosphère
et tombant sous forme de pluie, brouillard, neige, grêle.
Le terme 'lame d'eau tombée' est également employé
pour quantifier les précipitations. C'est également
un phénomène chimique qui fait se cristalliser certains
éléments en suspension dans l'eau. Par exemple, l'entartrage
des canalisations est dû à la précipatation
du carbonate de calcium (tartre)
sur les parois internes des conduites.
Prélocalisation : après avoir sectoriser
un réseau de distribution d'eau potable, la prélocalisation
des fuites d'eau permet de répérer avec plus de précisions
la zone du réseau où se situe la fuite. Généralement
exécutée la nuit, la prélocalisation consiste
à fermer successivement et à intervalle régulier
les vannes de sectionnement du secteur d'étude et de vérifier
au compteur situé à l'entrée de la zone de
sectorisation le débit de nuit. Cette méthode est
particulièrement appropriée aux réseaux
de type rural à structure ramifiée comme c'est
le cas au Syndicat de la Faye. On mesure de nuit, en général
entre 1h et 4h, les consommations enregistrées sur un compteur
divisionnaire après fermetures successives des vannes du
réseau, isolant chacune un secteur ou un tronçon.
Pression : action exercée par une force qui
presse sur une surface donnée; mesure de cette force. En
eau potable, on mesure la pression de l'eau en bar à l'aide
d'un manomètre.
Cette unité a remplacé une ancienne dénomination
qui pourtant était plus expressive : le kg/cm2.
La relation entre ces deux unités est simple : 1 bar = 1
kg/cm2. L'unité de masse par
rapport à l'unité de surface qualifie parfaitement
ce que représente la pression. En eau potable, l'eau atteint
la pression de 1 bar quand elle a parcouru un dénivelé
(ou une chute) de 10 m. En effet, une colonne d'eau de 10 m de haut
posée sur une surface de 1 cm2
pèse 1 kg comme le montre le schéma suivant :
|
|
 La pression exercée par une colonne d'eau de 10
m de haut sur une surface de 1 cm2
est de 1 bar
La pression exercée par une colonne d'eau de 10
m de haut sur une surface de 1 cm2
est de 1 bar |
|
Ainsi, dans un réseau d'eau potable, où
les canalisations sont en permanence pleines d'eau, lorsqu'un réservoir
se trouve 60 m au-dessus d'une maison qu'il alimente, l'eau arrivera
dans cette maison avec une pression de 6 bars soit 6 kg/cm2.
En effet, une colonne d'eau de 60 m de haut posée sur une
surface de 1 cm2 contient 6 litres
d'eau et pèse donc 6 kg.
Ce phénomène de pression peut avoir
des aspects négatifs en distribution d'eau potable car si
la pression de l'eau est trop forte, les canalisations en plastique
et en fonte peuvent être endommagées et subir des casses
ou des fuites à répétition. Pour lutter contre
ce phénomène, des ouvrages spécifiques, appelés
brise-pressions,
sont installés régulièrement sur le réseau.
Des appareils hydrauliques sont placés dans les brise-pressions
pour diminuer la pression de l'eau. Ce sont les régulateurs
de pression, appelés aussi, suivant les constructeurs,
réducteurs ou stabilisateurs de pression. Voici deux schémas
vous montrant le principe de fonctionnement des régulateurs
de pression :
|
|
Schéma de fonctionnement de 2 modèles de
régulateur de pression
|
|
Le principe de fonctionnement d'un régulateur
de pression est simple. Le régulateur de pression va maintenir
une pression d'eau en aval constante suivant la valeur que l'on
aura réglée. Cette pression ne variera pas quelque
soit la consommation des abonnés. En revanche, la pression
en amont du régulateur de pression va quant à elle
varier. Plus la demande d'eau en aval sera forte et plus le ressort
va se détendre, le piston s'abaisse et laisse passer plus
d'eau, la pression en amont diminue. Par contre, lorsque la demande
en aval est faible, le ressort se comprime et le piston bloque le
passage de l'eau tout en gardant une pression constante en aval.
C'est donc le ressort qui va plus ou moins "freiner" l'eau
qui arrive dans le régulateur. Les manomètres
placés sur le régulateur de pression permettent de
régler la pression au plus juste. Le schéma suivant
vous montre comment est constitué cet appareil hydraulilque.
|
|
Composition détaillée d'un régulateur
de pression aval
Modèle : REDAR RL (Ramus
Industrie)
|
|
La pression de l'eau est donc à la fois
un bien et un mal. Elle apporte un confort aux usagers qui peuvent
se servir de la force de l'eau dans leurs tâches quotidiennes.
En revanche, un excés de pression (phénomène
de coup de bélier
par exemple) peut avoir des conséquences fâcheuses
sur l'état des canalisations du réseau de distribution.
Pression atmosphérique : force exercée
par les couches de l'atmosphère
sur les couches inférieures et sur le sol.
Pressostat : contact électrique manoeuvré
par la pression d'eau. La pression agit sur une membrane et comprime
un ressort. Lorsque la valeur de tarage est dépassée,
le contact se ferme ou s'ouvre.
Principe de précaution : selon la Loi dite
Loi Barnier : "Principe selon lequel l'absence de
certitudes, compte-tenu des connaissances scientifiques et techniques
du moment ne doit par retarder l'adoption de mesures
effectives et proportionnées visant à prévenir
un risque de dommages graves et irréversibles
à l'environnement, à un coût économiquement
acceptable".
Prion : protéine anormale responsable de l'E.S.B.
(Encéphalopathie Spongiforme Bovine) dite "maladie de
la vache folle". La voie principale de transmission est l'ingestion
de produits bovins concentrant de grandes quantités de cette
protéine comme la moelle épinière ou la cervelle.
Les établissements manipulant ces matières à
risques (abattoirs, usines d'aquarrissage) constituent une source
de contamination potentielle pour les eaux de surface. Ces établissements
sont obligés de traiter leurs effluents par autoclavage (133
°C, 3 bar de pression pendant vingt minutes). Cette substance
présente relativement peu de risque dans l'eau potable à
cause du phénomène de dilution et de son hydrophobicité.
Cependant, aucune méthode analytique n'est disponible à
ce jour permettant de quantifier les prions en milieu aqueux. De
même, aucune investigation n'a été faite pour
connaître l'effet des désinfectants actuels sur les
prions.
Prix de l'eau : montant figurant sur la facture d'un
abonné et ramené au m3,
incluant les prestations : eau potable, collecte et épuration
des eaux usées, taxes et redevances, location de compteur.
Pour les abonnés domestiques, il est recommandé de
prendre une facture annuelle de 120 m3
pour le calcul du prix moyen au m3.
Programme de mesures : document à l'échelle du bassin
hydrographique comprenant les mesures (actions) à réaliser pour
atteindre les objectifs définis dans le S.D.A.G.E. révisé dont les
objectifs environnementaux de la directive cadre sur l'eau. Les
mesures sont des actions concrètes assorties d'un échéancier et
d'une évaluation financière. Elles peuvent être de nature réglementaire,
financière ou contractuelle. Le programme de mesures intègre :
- les mesures de base, qui sont les dispositions
minimales à respecter, à commencer par l'application de la législation
communautaire et nationale en vigueur pour la protection de l'’eau.
L'article 11 et l'annexe VI de la directive cadre sur l'eau donnent
une liste des mesures de base.
- les mesures complémentaires, qui sont toutes
les mesures prises en sus des mesures de base pour atteindre les
objectifs environnementaux de la directive cadre sur l'eau. L'annexe
VI de la directive cadre sur l'eau donne une liste non exhaustive
de ces mesures qui peuvent être de natures diverses : juridiques,
économiques, fiscales, administratives, etc.
Programme de surveillance de l'état des eaux :
ensemble des dispositions de suivi de la mise en œuvre de la directive
cadre sur l'eau à l'échelle d'un bassin hydrographique permettant
de dresser un tableau cohérent et complet de l'état des eaux. Ce
programme inclus : des contrôles de surveillance qui sont destinés
à évaluer les incidences de l'activité humaine et les évolutions
à long terme de l'état des masses d'eau, des contrôles opérationnels
qui sont destinés à évaluer l'état et l'évolution des masses d'eau
présentant un risque de ne pas atteindre les objectifs environnementaux
des contrôles d'enquête qui sont destinés à identifier l'origine
d'une dégradation de l'état des eaux. Le programme de surveillance
doit être opérationnel fin 2006.
Projet d'aménagement et de développement durable
(P.A.D.D.) : pièce constitutive du P.L.U.,
il comporte les orientations générales d'aménagement
et d'urbanisme retenues par la commune. Le P.A.D.D. peut en outre
comporter des orientations plus ciblées sur telle ou telle
partie du territoire communautaire. Depuis la loi sur l'Urbanisme
et l'Habitat de 2003, il n'est plus opposable aux tiers.
Protection des berges : action visant à réduire tout
type d'érosions des berges. Suivant l'objectif et les forces hydrauliques
s'exerçant sur la berge, diverses méthodes allant du génie végétal
à des interventions plus lourdes (perrés maçonnés, gabions, palplanches,...)
peuvent être utilisées.
Protozoaire : animal unicellulaire pouvant se retrouver
dans l'eau. Les protozoaires sont des cellules très différenciées,
remplissant les nombreuses fonctions nécessaires à
la vie et comportant des organites complexes, elles sont donc fort
différentes de celles qui constituent les tissus des métazoaires.
Pseudomonas aeruginosa : cette bactérie
vit à l'état saprophytique
dans l'eau (eau douce ou eau de mer), les sols humides et sur les
végétaux. Elle résiste peu au manque d'eau,
elle peut aussi vivre dans le tube digestif de l'homme et des animaux.
C'est un agent pathogène opportuniste. Elle provoque de nombreuses
infections (pulmonaires, urinaires...) et des gastro-entérites
aiguës par la production de toxines et d'enzymes. L'eau potable
ne doit pas en contenir.
Puisatier : professionnel dont la spécialité
est le creusement des puits.
Puits : ouvrage destiné à effectuer
un captage dans un nappe souterraine et constitué par une
cheminée verticale creusée jusqu'au niveau de la nappe
à capter.
Puits artésiens : excavation cylindrique creusée
dans les eaux profondes, d'où elles remontent en jaillissant.
C'est en Artois que l'on s'est occupé de rechercher des eaux
souterraines, de là le nom de puits artésien donné
à un puits foré.
Purge : placée au point bas du réseau
de distribution d'eau potable elle permet la vidange des conduites.
P.V.R. : voir Participation pour Voirie
et Réseaux.
Pyrolyse : décomposition chimique provoquée
par la chaleur. Procédé produisant des hydrocarbures
aromatiques polycycliques (H.A.P.) lors de la pyrolyse du charbon
ou du pétrole et pouvant polluer l'eau potable. |
|
|
|